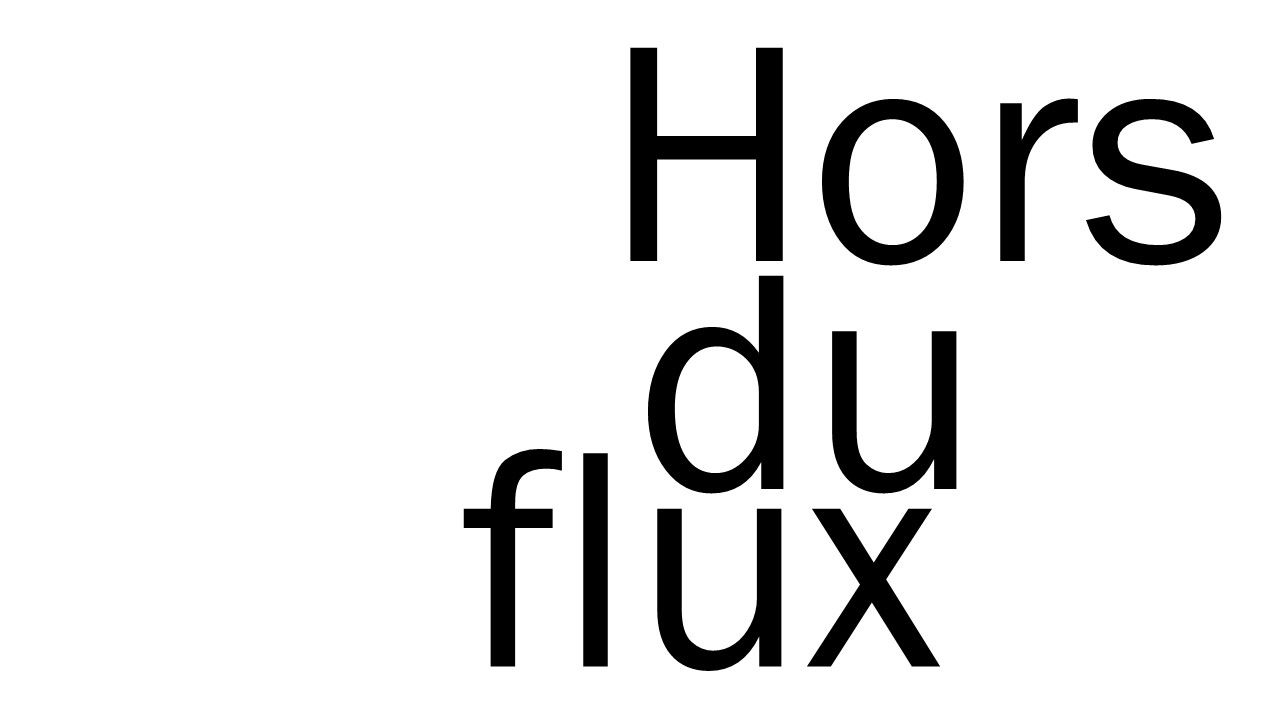Au Commencement était... tentative de synthèse

Sur quoi repose le monde ? Je ne parle pas ici du monde physique, mais de celui qu’on construit collectivement, l’édifice imaginaire qui fonde le possible et l’impossible, les croyances et les peurs : le bocal dans lequel nous nageons sans le savoir. Ce monde là repose sur des récits, des croyances, des présupposés, que nous voyons d’autant moins qu’ils sont répétés et sonnent comme des évidences. Ainsi, nos structures sociales actuelles et en particulier l’État nous semblent être la conséquence logique d’une progression linéaire de l’humanité. Les tribus éparses se sont trouvées confrontées à une logique implacable avec la découverte de l’agriculture : les excédents se sont accompagnés de la création de castes privilégiées et la complexité liée à l’évolution de la taille des groupes humains a entrainé l’apparition d’une organisation verticale. Le guerrier, le prêtre, le roi, ou encore le scribe apparaissent avec l’agriculture, sorte de piège de l’évolution dans lequel nous sommes tombés (pour reprendre ici la thèse d’Harrari dans Sapiens). L’État, le pouvoir, la verticalité sont là, en germe, derrière le geste du premier (de la première ?) à avoir planté un grain de blé domestiqué.
Les livres sont pour moi, d’abord, l’occasion de quitter le quotidien et d’étendre mon univers. J’ai beaucoup lu d’héroïc fantasy dans ma jeunesse, à la recherche de cette perception d’un monde immense et inconnu loin de l’ennui de la “réalité”. “Au Commencement était”, le dernier ouvrage de David Graeber, écrit avec David Wengrow, un archéologue, est en ce sens un livre d’héroïc fantasy. Mais d’une fantasy encore plus passionnante, car le monde immense qui est décrit, aussi baroque et étrange qu’il soit est le notre. C’est le genre de livre qui change le monde, celui que l’on construit activement chaque jour, en ce qu’il détruit méthodiquement un certain nombre de ses piliers imaginaires !
Les auteurs y répondent à question fascinante : l’être humain, tel qu’on le connait, a 200 000 ans et est sorti d’Afrique il y a 60 000 ans. Nous racontons largement les histoires de nos 2 000 dernières années. Mais que s’est-il passé durant toutes ce temps : le paléolithique, le néolithique, l’âge du bronze, etc. ? Notre image mentale, portée par les récits de Rousseau ou de Hobbes est celle d’un état originaire, antichambre de l’histoire. Temps bénis (Rousseau) ou lutte de tous contre tous (Hobbes), cela revient au même : c’est plusieurs dizaines de milliers d’années d’histoires, de civilisations, de mythologies, d’espoirs, de rêves, de rapports au monde qui sont ramenés à une description simplissime. Or, Graber et Wengrow nous donnent à voir, grâce aux dernières recherches archéologiques et à leur talent de conteur, les mondes qui nous ont précédés, dans leurs variétés, leurs ambitions, leurs caractère infiniment passionnant. Leur propos global est que nos représentations et notamment celle d’un basculement de l’humanité dans un engrenage sans fin, depuis l’apparition de l’agriculture jusqu’à aujourd’hui, avec notamment l’apparition de l’Etat et des inégalités, sont… fausses. Factuellement fausses. Et que ça change tout.
Ce livre est assez simplement impossible à résumer. La prose est d’une matière incroyable. C’est un récit d’une fluidité qui tend parfois au roman à suspens, tout en apportant des contenus passionnants et des apports théoriques bouleversants. Nassim Taleb (un autre auteur que j’adore) parle, à son propose, de “festin intellectuel”. On ne peut pas dire mieux.
Alors, plutôt que de tenter de le résumer, je vais tenter de suivre quelques lignes et de décrire avec mes mots des outils conceptuels qui, je pense, pourraient nous être utiles.
1/ Sortir de la linéarité et de la téléologie
Un des propos de fonds du livre tient dans le renversement de perspective par rapport à nos approches téléologiques. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les chercheurs ou les intellectuels qui adoptent une perspective globale sur l’histoire humaine le font avec, en tête, notre situation actuelle, comme si celle-ci était le point avancé de la flèche du temps, et qu’ils expliquent les différentes séquences de l’histoire humaine comme autant d’étapes pour arriver là où nous en sommes. Ils démarrent par la conclusion, notre situation, comme une situation nécessaire (qui ne peut pas ne pas être) et enfilent les perles des étapes passées, en expliquant pourquoi chaque étape portait en elle la suivante.
Or, cette approche pose un problème majeur : en regardant rétrospectivement les sociétés anciennes, on passe à côté de la dimension contingente des évolutions, les différentes façons d’être au monde qui étaient opposées à la notre et qui pourtant marchaient. On ne peut donc pas voir en quoi notre propre société pourrait être différente.
L’agriculture et son impact sur la stratification des sociétés humaines est un exemple parfait. Nous vivons aujourd’hui dans un monde où elle a triomphé et permis le passage de 5 millions d’être humains au début de l’holocène à 900 millions il y a 200 ans et à plusieurs milliards aujourd’hui. L’idée, évidente, que nous avons est : comment croyez-vous que nous pourrions gérer de grandes masses d’humains et les nourrir sans système agricole et organisation verticale ?
Or, ce que montrent les recherches est à mille lieu de l’image de l’agriculture comme “cliquet” (un passage dont on ne peut plus revenir). La découverte de l’agriculture a précédé de plusieurs milliers d’années les premiers États, là où les recherches montrent qu’il ne faut que 200 ans au maximum pour domestiquer le blé. Par ailleurs, elle a en de multiples endroits été abandonnée, preuve que le retour en arrière était possible. En réalité, les premières pratiques agricoles ressemblaient plus à de la botanique : des expérimentations que les auteurs appellent “l’agriculture en dilettante”, pratiquée notamment dans les bordures de fleuves très fertiles, où il suffisait de semer pour récolter. Tout montre que les sociétés anciennes se gardaient bien de se lancer dans l’agriculture telle qu’on la connait, car ils en voyait les limites. Les sociétés de chasseurs cueilleurs étaient des sociétés d’abondance qui, effectivement, n’avaient pas besoin de l’agriculture et qui d’ailleurs ont choisi de fonctionner autrement.
Une fois que l’on comprend ça, on peut enfin regarder les différentes civilisation pour ce qu’elles sont, de formidables expérimentations sociales et des possibilités de monde alternatifs, plutôt que les marches qui mènent au capitalisme mondialisé.
2/ Développer une vision systémique de l’histoire
Sortir d’une vision linéaire de notre passé permet d’ouvrir les yeux sur la complexité du réel et d’observer l’histoire d’un point de vue des influences, des liens, bref, d’un point de vue systémique (“L’un des défauts du modèle évolutionniste est qu’il réorganise en stades historiques distincts des modes de vie qui se sont développés en symbiose.” p. 576).
Le livre évoque plusieurs exemples fascinants de ces phénomènes de liens entre les groupes humains et d’influences mutuelles. Le cas des barbares, développé par James C Scott, un autre anthropologue (anarchiste aussi, comme Graeber !) est passionnant. Il montre que de -3 000 à 1 600, les États en émergence oppressaient largement leurs populations, notamment à travers le choix des cultures céréalières (le blé est visible, il pousse à une date fixe, c’est donc facile pour le collecteur d’impôt de passer au bon moment), là où les barbares qui vivaient en marge de ces sociétés avaient la belle vie. L’histoire des civilisations céréalières peut donc être vue dans son lien avec les barbares : dans des cycles qui recommençaient, les barbares menaçaient les États, parfois les conquéraient, mais alors ils devenaient des monarques sédentaires qui de nouveau étaient menacés de l’extérieur, ou alors, ils devenaient l’armée de l’État.
L’autre cas d’interaction comme phénomène déterminant des destinées des groupes humains est ce qu’ils nomment, d’après Gregory Bateson (un des fondateurs de l’école de Palo-Alto), la schismogénèse. Mot compliqué pour décrire une réalité simple : la tendance qu’ont les éléments d’un système à entrer en relation tout en se différenciant activement les uns des autres. On l’observe dans le cadre familial (objet d’étude de Gregory Bateson, les frères et sœurs tendent à se polariser) mais aussi entre les sociétés.
Pour l’illustrer, il faut comprendre que les sociétés anciennes ne vivaient pas isolées mais, à travers les échanges et les voyages, appartenaient à de vastes aires culturelles qui étaient conscientes de l’existence d’autres modes de vie. Ce qui amène à renverser la logique sur la question des emprunts culturels :
“En effet, si l’on partait du principe que chacun savait plus ou moins ce que fabriquait le voisin et pouvait aisément avoir accès aux coutumes, aux arts et aux technologies étrangers, il ne fallait pas se demander pourquoi certains traits culturels se diffusaient, mais plutôt pourquoi les autres ne le faisaient pas. Pour Mauss, la réponse tenait précisément au fait que les cultures se définissent par opposition les unes aux autres, à travers le “refus de l’emprunt”. Les Chinois mangent avec des baguettes et n’utilisent ni couteaux, ni fourchettes ; les Thaïlandais utilisent des cuillères, mais pas de baguettes ; et ainsi de suite.”
On le voit, le désir (actif) de se différencier du voisin (la schismogénèse) est, selon les auteurs, une des forces majeures qui peut expliquer les évolutions propres à chaque sociétés (plutôt que les déterminants géographique, économiques, biologiques ou autre).
Dernier exemple, assez spectaculaire celui-là, des liens et des influences comme moteur de l’histoire humaine : les auteurs avancent que les idéaux des lumières, le débat rationnel et la liberté ont été des apports liés aux échanges avec les indiens d’Amérique du Nord qui avaient effectivement développé ce genre de culture. Au delà des individus, on voit comment les idées peuvent “infecter” les civilisations et c’est magnifique !
3/ Plaidoyer pour l’imagination et la rationalité
Graeber et Wengrow rejettent les grands récits déterministes pour remettre au cœur de notre lecture de l’histoire humaine la capacité à s’auto-déterminer. Ils s’opposent en cela à une certaine approche scientifique : “Les partisans du déterminisme environnemental ont une fâcheuse tendance à prendre les humains pour des automates à peine améliorés qui vivraient le fantasme de calcul rationnel de quelque économiste.”
C’est à un changement de regard qu’ils nous invitent : considérer que nos ancêtres, comme nous, étaient capables de réflexion, de doutes, de critiques : “Ce n’étaient ni des sauvages ignorants, ni de sages enfants de la nature, juste des gens comme nous (...) : tout aussi perspicaces, tout aussi perdus.” Ce qui implique qu’ils se posaient des questions politiques : “Lorsqu’on commence à comprendre ce que raconte les preuves archéologiques, force est de constater que la vie sociale des premiers humains était infiniment plus complexe et plus excitante que ne l’imaginerait n’importe quel théoricien moderne de l’état de nature” (p . 30). Il s’intéressent en particulier à la capacité de conversation, qui leur semble être la clé des capacités des civilisations humaines égalitaires pour penser leurs modes de fonctionnement et le faire évoluer. “Si l’on admet que le propre des humains, en tant qu’acteurs politiques conscients, et d’être capables de choisir parmi un grande variété de modes d’organisation sociale, cela ne devrait-il pas impliquer qu’ils ont exploré ces possibilités tout au long de leur histoire? “ (p. 116 )
Ce passé qui revient, devient donc un réservoir de possibilité et une autorisation à imaginer d’autres modes d’organisation. Si des groupes de plusieurs milliers d’humains ont réussi à fonctionner ensemble, faire avancer leur science et célébrer leur dieu, en paix et sans structures verticales, alors, on devrait faire mieux que ce que nous faisons aujourd’hui.
4/ Sagesse ancienne : Intelligence actuarielle et saisonnalité
En plus d’être des individus comparables à nous sur le plan intellectuel, nos ancêtres avaient aussi quelques caractéristiques qui nous sont devenues étrangères. En effet, il existe un pan de l’anthropologie qui, avec Pierre Clastres (encore un anthropologue anarchiste), décrit les sociétés sans État non comme des sociétés qui ne seraient pas encore suffisamment développées, mais plutôt comme des groupes d’humains ayant l’intuition de ce qu’ils pourraient devenir si l’État apparaissait et qui donc font tout pour l’empêcher.
C’est ainsi qu’on peut expliquer certains comportements assez troublant parmi différentes sociétés et que l’on regroupe sous le concept d’ “intelligence actuarielle” : rabaisser systématiquement les chasseurs les plus doués, faire répartir la viande par un individu au hasard (plutôt que par celui qui l’a tué), humilier les chefs, les tourner en dérision... Il s’agit pour les communauté d’anticiper les pentes du pouvoir et de tout faire pour limiter l’apparition de situations de domination. C’est un retour à l’essence de ce qu’est la politique : envisager les directions qui s’offrent à nous et en choisir une en conscience.
Une partie de l’explication de la capacité de ces civilisations anciennes à anticiper l’apparition de l’État et à faire preuve de cette intelligence actuarielle est à trouver dans la nature saisonnière de leurs organisations politiques. C’est une idée qui m’a ouvert les yeux : les groupes humains n’étaient pas des clans, ou des tribus, ou des chefferies. C’était à un certain moment de l’année de petits groupes familiaux, répartis sur de vastes étendues, et pendant quelques semaines, des grands ensembles de plusieurs milliers d’individus réunis pour des chasses au bison ou de grands rites, avec des règles et des modes de fonctionnement complètement différents. Ainsi les Indiens des plaines en Amérique du Nord qui se réunissaient à la fin de l’été en larges congrégations pour assurer la préparation logistique de la chasse au bison. A cette époque de l’année, une police spéciale était mise en place, qui était extrêmement dure, avec parfois des mises à mort. Chaque année, un clan différent assurait la fonction de police, afin de s’assurer que ça ne devienne pas une situation d’abus possible. Dès que la saison de la chasse au bison prenait fin, on revenait à une culture politique extrêmement libertaire.
La conséquence de ces modes de fonctionnement saisonniers selon Graeber et Wengrow : ces sociétés avaient la possibilité de prendre du recul sur les modes d’organisation en vigueur (puisque ceux-ci variaient dans le temps), en conséquence de quoi, c’est toute une liberté politique qui existait, avec l’autorisation intellectuelle et pratique à expérimenter.
5/ L’étrangeté de la propriété
La propriété privée structure nos sociétés. Droit fondamental, la propriété est donc aussi vue parfois comme le problème originel de nos sociétés (Rousseau : le premier qui a dit “c’est à moi ici”…). Graeber et Wengrow viennent ici encore détruire nos représentations.
A partir des observations ethnographiques de sociétés égalitaires, ils établissent une correspondance troublante entre notre vision de la propriété et le domaine du sacré. Dans ces sociétés, aucun objet, ni aucune chose ne peut faire l’objet de propriété “contre” les autres. Les objets passent de main en main (et se retrouvent régulièrement finalement possédées par les enfants) et plus globalement, aucun adulte ne peut donner d’ordre à un autre adulte. Cela est vrai dans une immense majorité du temps… sauf dans la sphère du rituel et du sacré. Chez les Hadzas de Tanzanie ou au sein de populations pygmées, par exemple, l’initiation aux cultes masculins forme la base de revendications exclusives de propriété en contraste radical avec la vie de tous les jours. Et ce rapport à la propriété exclusive s’accompagne de grandes violences. Dans les rites initiatiques du désert occidental d’Australie, chez les Arandas, on fait intervenir des reliques qui sont comme des droits de propriété de portion de terre ; chaque rite de croissance des Arandas est l’occasion de confier aux jeunes la responsabilité de prendre soin des reliques et des terres. Le poids de cette charge se transmet par la terreur et la mutilation : circoncision, subincision - obéissance aveugle aux ordre des anciens, là où le reste du temps les enfants sont gâtés et ne font l’objet d’aucune discipline.
Ce qui marque les auteurs, c’est le trait fondamental qui lie la notion de propriété privée et celle de sacré : toutes deux sont prioritairement des structures d’exclusion. Pour Durkheim, le sacré c’est la mise à part du monde, sur un piédestal et le tabu, ce qui ne doit pas être touché. Et les auteurs de s’étonner : “souligner ce parallèle entre propriété privée et sacré permet de mieux comprendre ce que la pensée sociale européenne a d’étrange du point de vue historique : contrairement aux sociétés libres, nous avons fait de la qualité absolue, sacrée, de la propriété privée le paradigme de l’ensemble des droits et libertés humains.”
Le point supplémentaire qui caractérise l’étrangeté de notre droit de la propriété, c’est comment celui-ci est un droit de destruction. Dans le droit romain, la propriété recouvre : usus (user), fructus (jouir des produit - les fruits de l’arbre) et abusus (disposer : endommager, détruire) - la propriété se définit donc par la possibilité de ne pas prendre soin du bien, voire de le détruire à sa guise. A comparer avec les sociétés indigènes d’Amazonie, où tout ce qui les entourait : lac, montagnes, animaux, pouvait avoir un propriétaire, mais où la propriété comportait une double dimension de domination et de soin. Ou encore avec les système totémique : on possède l’animal, ce qui signifie qu’on n’a pas le droit de le tuer, voire qu’on doit faire des rituels pour son épanouissement.
La question des auteurs est donc, non de se savoir quand la propriété privée est apparue (dès le départ, en même temps que le sacré), mais pourquoi ce qui était l’exception et qui correspondait à un champ très limité des affaires humaines est devenu la règle et a pu structurer tant d’autres aspects de l’existence humaine.
6/ Pourquoi des leaders ?
Un des propos les plus forts du livre tient dans la problématisation du rôle de “chef”, ou de “leader”. Nous avons intégré comme une évidence que des grands groupes humains doivent être gouvernés par un petit nombre de personnes, hors l’essentiel du livre montre qu’il n’en est rien : il n’y a aucune conséquence logique entre taille du groupe et nécessité de l’émergence d’une caste de gouvernants.
Il existe cependant, au sein des premières tombes identifiées qui datent du pléistocène des personnes qui sont enterrées avec les honneurs : bijoux, armes, parures. Or la majorité des squelettes des monuments funéraires retrouvés portent la marque d’anomalies physiques frappantes qui devaient les distinguer de leur entourage de façon spectaculaire : malformation congénitale, nains, bossus, géants - et on ne peut pas voir sur des cadavres si ils étaient albinos ou épileptiques... Celles et ceux qu’on imagine être leur Princesses ou leur Prince… présentaient donc des difformités extrêmement importantes !
Cela s’explique notamment par ce que les anthropologues ont montré comme étant un des traits les plus saillant des sociétés primitives : leur tolérance à l’excentricité. En allant plus loin, on peut poser la question : et si, pour les chasseurs cueilleurs du pléistocène, les farfelus, les excentriques représentaient un “réservoir” intellectuel et de talents pour les crises ou les évènements inattendus ? C’est la thèse de Graeber et Wengrow : des gens qui, chez nous seraient bons pour l’hôpital psychiatrique étaient non seulement toléré, mais parfois aussi placés en position de chef, preuve en est qu’ils occupaient ces tombes royales à leur mort.
On peut faire cette observation en parallèle du principe de saisonnalité : “Avec une telle souplesse institutionnelle, il devient possible de s’affranchir des limites de sa propre société et de prendre du recul pour l’examiner - en somme, de faire et défaire les mondes politiques qui sont les nôtres. Ainsi s’explique sans doute le mystère des “princes” et “princesses” du Pléistocène qui nous apparaissent dans leur splendide isolement, comme les personnage d’un conte de fées ou d’un drame costumé - peut-être d’ailleurs n’étaient-ils rien d’autre que cela. S’ils leur arrivait de régner, ce n’était probablement que le temps d’une saison [...]” (p. 148)
Le second point qu’ils mettent en avant, c’est le rôle de la compétition charismatique comme une des composantes possibles des “États”. Pour les auteurs, ce que nous appelons aujourd’hui “démocratie”, revient en réalité à mettre en concurrence des personnalités remarquables pour l’obtention du pouvoir pendant que le reste d’entre nous observe, passifs. Or, ce dispositif est loin, très loin, du principe de démocratie. Il serait apparu à partir de - 3 100 avec les “sociétés héroïques” : des groupes humains qui, en marge des villes et de leur fonctionnement égalitaire (où les femmes avaient un rôle important) s’organisent en gommant toute trace de bureaucratie. Les archéologues observent “un modèle de sépulture héroïques qui trahit l’émergence d’une culture axée sur la ripaille et la beuverie, ainsi que sur la figure du guerrier mâle dans toute sa gloire et sa splendeur.” (p. 396). “Les aristocraties, voire la forme monarchique elle-même, seraient ainsi nées en réaction aux cités égalitaires des plaines mésopotamiennes.” (p. 398)
7/ La liberté plutôt que l’égalité
Finalement, un des points essentiels du livre tient dans la nécessité de reconsidérer la quête de l’égalité et de la voir comme une fausse question, pour être plutôt attentif à la liberté comme réalité concrète.
Pour Graeber et Wengrow, questionner l’inégalité de nos sociétés revient, de façon plus ou moins explicite à supposer un état antérieur d’égalité entre les hommes. Or, si la confrontation avec des peuples ayant vécu d’autres histoires suite à la “découverte” des Amériques en 1492 nous a appris quelque chose, c’est que les sources d’étonnements des Indiens ayant pu interagir avec nos sociétés n’avaient pas à voir avec la question de l’égalité matérielle en elle-même mais de comment celle-ci pouvait se transformer en inégalité de pouvoir.
Ce qui importe, pour les auteurs, c’est, au fond, la capacité d’action des groupes humains. Ainsi, on peut tordre cette question de l’égalité : faut-il que tous les individus soient les mêmes, ou qu’ils soient si dissemblables que les comparaisons et les interventions croisées ne sont pas possibles ? Ainsi des femmes et des hommes dans certains groupes : clairement incomparables, ils vivaient dans des univers de droits et de devoirs différents ce qui leur laissait la possibilité de s’organiser eux mêmes. Est-ce de l’égalité ? Pas sûr. En tout cas, c’est de la liberté.
Ils comparent notre liberté théorique à celle, réelle, des Indiens d’Amérique du Nord. “on pourrait presque dire que, si les Wendats [une tribu nord américaine] avaient de faux chefs, mais de vraies libertés, beaucoup d’entre nous doivent aujourd’hui se contenter de vrais chefs et de fausses libertés”. Ainsi, par exemple, du droit de voyager. Nous avons aujourd’hui accès à de multiples moyens de transport et sommes “libres”, en tant qu’Européens, de pouvoir aller partout. Les Indiens, eux, étaient moins intéressés par le droit de le faire que par la possibilité concrète de mettre en œuvre leur projet. Ce qu’ils faisaient régulièrement, n’hésitant pas à s’engager dans des voyages de plusieurs semaines, suite à un rêve notamment. Avec, en pendant, la condition clé : l’hospitalité. Globalement : “Quitter les siens avec la certitude de trouver ailleurs un bon accueil, changer de structure sociale au gré des saisons, désobéir aux autorités sans que cela prête à conséquence : autant de libertés qui nous paraissent à peine concevables aujourd’hui, mais qui constituaient de simples données pour nos lointains ancêtres.” (p. 174)
La question devient donc, pour nos auteurs : non pas quelle est l’origine des inégalités, mais qu’avons-nous perdu avec notre développement qui nous a éloigné de ce qu’ont vécu les hommes durant une majorité de notre histoire ? Pourquoi nous sommes-nous enfermés, fiers de nous-mêmes, dans des systèmes qui nous contraignent largement plus que ce que vivaient nos ancêtres ?
Conclusion
“Si l’humanité a bel et bien fait fausse route à un moment donné de son histoire - et l’état du monde actuel en est une preuve éloquente -, c’est sans doute précisément en perdant la liberté d’inventer et de concrétiser d’autres modes d’existence sociale.” (p. 635) le livre de Graber et Wengrow est une invitation à renverser notre regard sur nos modes d’organisation collective, pour se redonner justement cette capacité à agir. Il est temps !
Pour cela, en plus de nous proposer un paradigme alternatif pour expliquer les constructions sociales, le livre propose un certain nombre d’outils. J’ai essayé d’en décrire certains ici :
- Revaloriser la contingence de nos sociétés et ne pas considérer que notre monde actuel est nécessaire, mais qu’au contraire, il existe des tonnes de possibles à explorer, l’histoire de l’humanité le prouve - ouvrons le champ intellectuel des possibles
- Comprendre à quel point la complexité de nos interactions entre groupes humains nous forge, et que les idées peuvent traverser des continents pour nous infecter - nous ne sommes pas des îles, laissons nous toucher
- Cesser de nous percevoir comme des êtres avancées comparées aux civilisations primitives et réaliser qu’ils étaient aussi intelligents que nous et plus audacieux politiquement - réapprenons à avoir des conversations sur nos façons de faire société
- Considérer la variation des modes d’organisation comme une norme historique et muscler notre intelligence actuarielle, en mettant en place des comportements limitants pour éviter au pouvoir de devenir une fin en soi - oui, humilions les chefs !
- Sortir de notre vision de la propriété comme droit de détruire et remettre la notion de soin au centre - c’est dans la capacité de soin que tout se joue
- Se méfier des jeux électoraux, et de la course politique, qui sont l’apanage de schémas aristocratiques et s’ouvrir aux excentricités, pour faire face aux temps troubles qui s’ouvrent devant nous - on a besoin de leaders différents et provisoires, pas de combats de coqs
- Enfin, récupérer comme valeur fondamentale la liberté, non pas celle qu’on écrit sur le fronton des Mairies mais celle bien plus concrète qui permet de désobéir, de partir, ou d’inventer d’autres modes d’organisation - la liberté ne s’use que quand on ne s’en sert pas
Cet article ne fait qu’effleurer maladroitement la puissance du livre, je ne peux que vous inviter à vous y plonger !