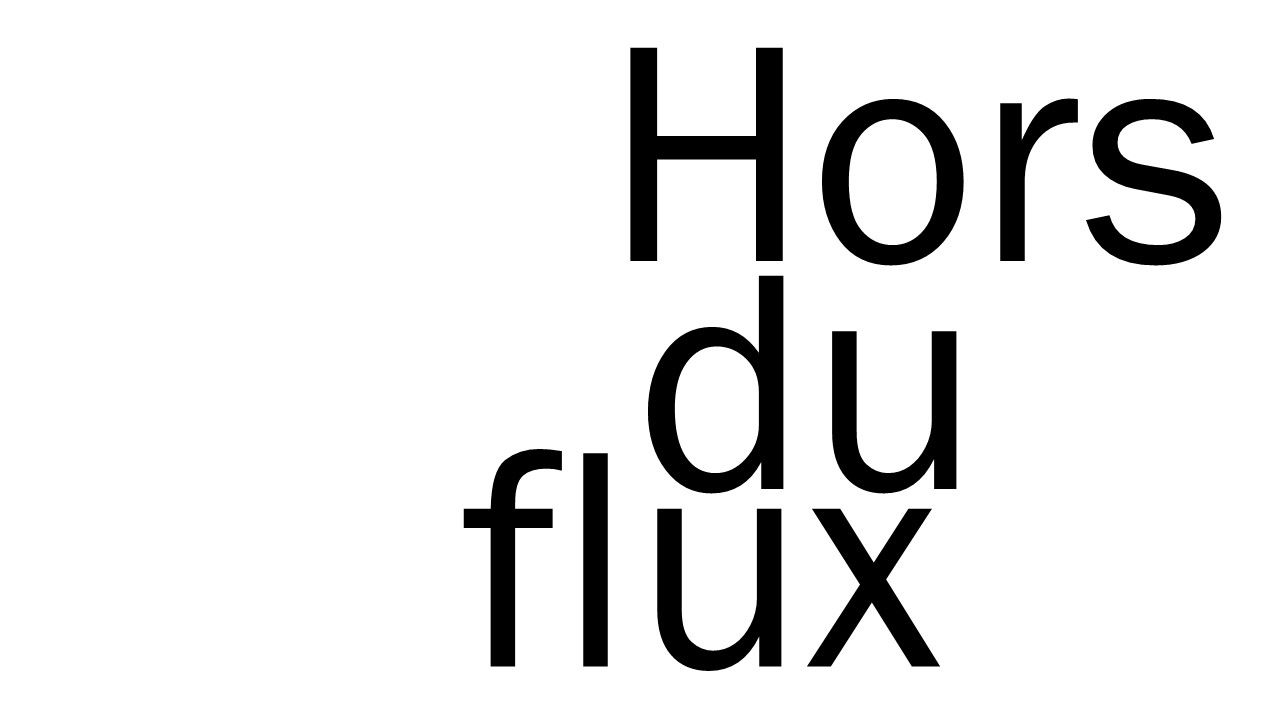Synthèse de Politiser le renoncement
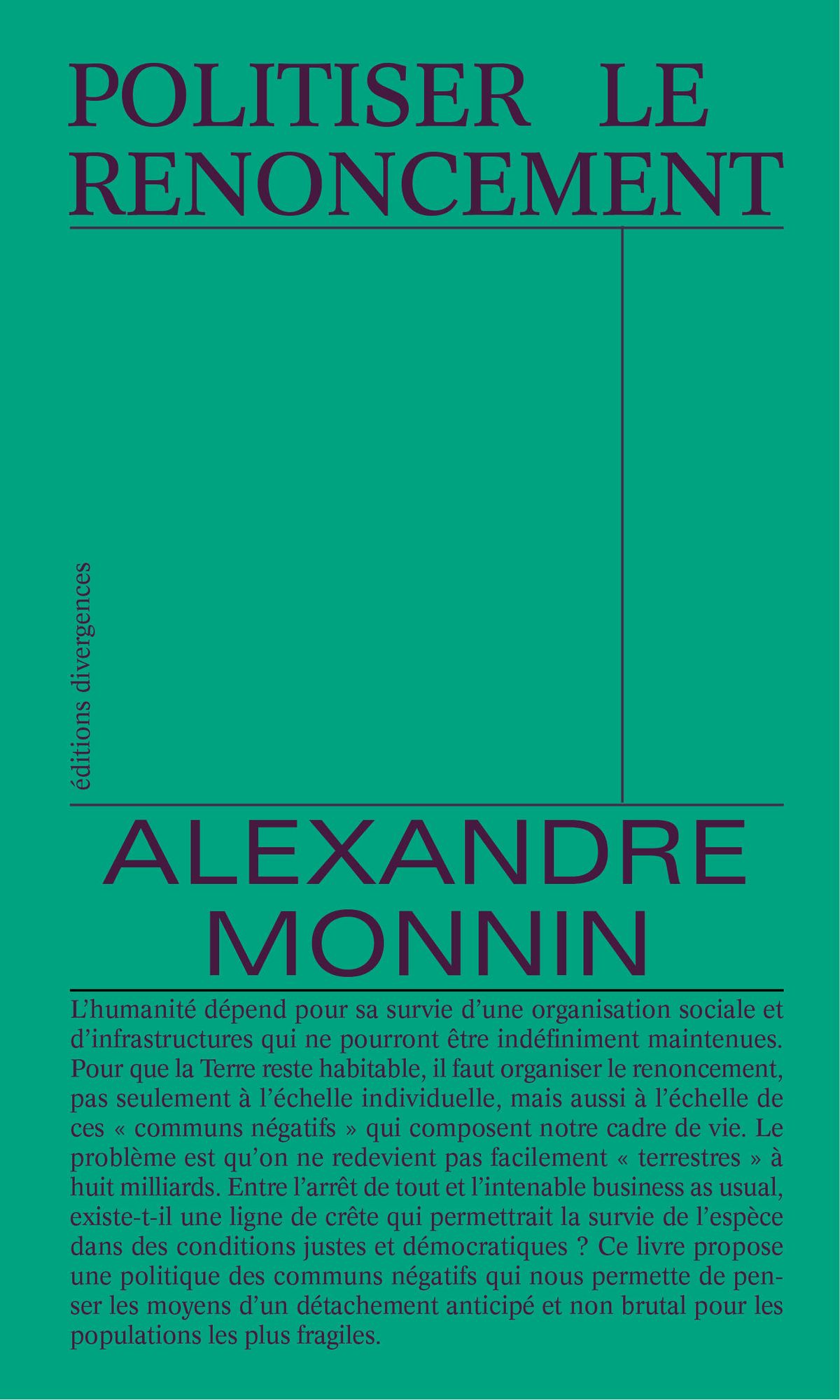
Que faire face à la crise écologique ? Selon Alexandre Monnin, philosophe, co-initiateur et directeur du MSc Strategy and Design for the Anthropocene, il faut faire collectivement l’inventaire de ce que nous lègue le XXème siècle : que voulons-nous garder et à quoi devons-nous renoncer ? C’est le chemin qu’il explore dans son livre, Politiser le renoncement, dont je vais tâcher d’offrir ici une synthèse.
Préambule important : il s’agit d’un livre exigeant, qui se lit bien mais qui reste difficile. Mon projet de synthèse vise à la simplification afin de pouvoir “utiliser” ces idées. Il est fort possible qu’au passage je trahisse en partie la pensée de l’auteur ! N’hésitez pas à me corriger (et surtout à lire le livre si le sujet vous intéresse).
Le problème : arpenter la ligne de crête entre le business as usual et un retour à la nature
Que faire alors ? Pour bien poser la question, il s’agit d’abord de caractériser la situation. Quel est notre problème ? Pour Alexandre Monnin, notre problème tient dans la nécessité de travailler sur une ligne de crête entre deux réponses possibles à la catastrophe en cours.
D’un côté, le business as usual
D’un côté, ce terrible business as usual. Le bateau qui continue sur sa lancée, sans s’arrêter, vers l’abîme. Et qui ne perçoit pas les trajectoires, les tendances, les devenirs qui pourtant sont clairs : notre économie repose sur une logique extractiviste qui est déjà caduque mais ne le sait pas encore. On attend la nouvelle technologie qui nous sauvera, sans comprendre qu’on ne peut déjà soutenir celles qui nous portent aujourd’hui. On cherche le salut dans le nouveau, alors que l’ancien est là qui va nous demander des comptes.
L’exemple de la crise de l’azote aux Pays-bas est, en ce sens, probant. Du fait de la trop forte production d’azote liée à l’agriculture intensive, le pays a dû prendre d’urgence des mesures drastiques sous contraintes légales. Un gouvernement (de droite) a limité la vitesse des autoroutes de 130 km/h à 100 km/h pour pouvoir de nouveau construire des bâtiments et respecter ainsi les limites imposées d’émission d’azote. Les Pays-Bas sont ainsi devenus un “laboratoire mondial de la fermeture, du renoncement” et ont montré, en partie, le mauvais exemple : pas d’anticipation, pas de concertation et un décrochage brutal.
De l’autre, le retour à la nature
De l’autre côté, une partie des pensées écologistes se retrouvent dans ce que l’on pourrait regrouper comme les pensées du vivant. Retour à la terre, connexion aux sagesses anciennes, déséconomisation… Il s’agirait de couper avec le monde industriel pour retrouver les seules façons de faire qui soient compatibles avec la vie sur terre. Problème : la technosphère, qui désigne l’ensemble des objets (dont le poids dépasserait celui des êtres vivants), mais aussi les techniques, les processus associés, ne va pas disparaître même si nous décidons tous d’un retour aux champs. Autre problème : il va falloir dire adieu à votre ami diabétique qui n’aura donc plus sa dose d’insuline, du fait de la rupture avec les chaînes de production. Pas le choix donc, nous devons aussi hériter d’une partie de l’infrastructure et des techniques qui fondent la civilisation thermo-industrielle.
Fermeture d’un côté, héritage de l’autre pour reprendre les termes du précédent livre collectif de l’auteur.
La problématique : renoncer collectivement pour garantir la viabilité
Il s’agit donc de renoncer collectivement à certaines choses, certaines technologies, certaines façons de faire, sans tomber dans le fantasme dangereux d’un retour en arrière. Construire un monde d’après sur les ruines de celui-ci. Et le faire de façon démocratique.
“L’enjeu du renoncement ici posé concerne le renoncement collectif motivé par des questions de viabilité. Comment emprunter une ligne de crête entre une rupture immédiate et brutale des dépendances vis-à-vis de la technosphère et le business as usual, l’inaction synonyme d’aggravation du péril anthropocénique ?”
Alors que faire ?
Le concept : les communs négatifs
Au départ, les communs
Pour travailler sur un nouveau problème, il faut un nouvel outil. Alexandre Monnin propose d’utiliser le concept de “communs négatifs”. Un commun, c’est au départ un objet des sciences économiques. Dans un article qui est devenu un classique, Garret Hardin parle en 1968 de la “tragédie des communs”, où le fait de partager une ressource (par exemple un pâturage) conduit à sa surexploitation, car tout le monde a intérêt individuellement à l’exploiter un peu plus. Elinor Olstrom, de son côté, propose en 1990 une lecture différente du phénomène des communs. A partir d’études empiriques rigoureuses, elle montre qu’une communauté peut gérer collectivement une ressource sans nécessairement passer par le marché ou l’état (ce qui était la conclusion logique de la tragédie des communs). De ses observations, elle fait émerger un certain nombre de règles de gouvernance qui permettent à des communautés de gérer de façon autonome des ressources aquifères ou des systèmes d’irrigation par exemple.
Les communs négatifs : des déchets aux ruines ruineuses
Les communs négatifs, c’est lorsque la chose qui est en commun n’est pas une ressource mais plutôt un “coût”. Les déchets par exemple, tels qu’ils sont gérés dans nos sociétés industrielles, sont un “commun”. Mais, dans notre système, ils ne représentent qu’un coût (de gestion des flux par ex.). Un cran plus loin les déchets nucléaires représentent aussi un commun, qu’il s’agit nécessairement de “gérer”, qui plus est sur le temps (très, très) long.
L’auteur prolonge son explication de ce que sont les communs négatifs en exposant l’idée de ruines : “il faut imaginer les paysages de l’Anthropocène, les rebuts de la technosphère, les infrastructures en déshérence, les sols pollués, les rivières asséchées…”. Ces ruines sont déjà “ruinées”. Il faut les gérer mais elles ne produisent plus de dégâts. Au contraire des “ruines ruineuses”, toujours en action : modèles économiques qui rendent profitables la mine à ciel ouvert ; réalités techniques, managériales, économiques, logistiques qui fondent le système économique actuel. Ces ruines ruineuses sont aussi des communs négatifs dont nous héritons car “une part toujours croissante de la population mondiale leur est liée à court terme, alors même que leur fonctionnement constitue le plus grand péril qui soit pour l’habilité de la planète à moyen terme.”
L’approche : il s’agit d’une entrée nécessairement politique
Penser au delà de la résilience et entrer dans des processus de valuation
Il s’agit de bien comprendre que ces communs négatifs (du pétrole, aux flux logistiques mondiaux en passant par les émissions radioactives et notre addiction aux smartphones) ne sont pas des externalités négatives, des coproduits accidentels que fabriquerait malheureusement le capitalisme. On ne peut à la fois espérer conserver le système actuel et espérer en limiter ses dégâts. Le système, c’est les dégâts : “Quand on achète un avocat, on achète le Mexique qui va avec”, c’est-à-dire la culture intensive, la privatisation de l’eau, l’exploitation des travailleur·ses…
Le souci qui se pose, si l’on souhaite utiliser le concept de commun négatif, c’est que contrairement à son cousin “positif”, le commun négatif (un fleuve pollué, le CO2 dans l’atmosphère, les mines de lithium…) n’entretient pas de lien organique avec une communauté humaine localisée et définie. En ce sens, le commun négatif se distingue des approches de la résilience, où il s’agit essentiellement de renforcer les populations touchées par une catastrophe.
Utiliser le concept de commun négatif implique donc nécessairement d’entrer dans une démarche politique. Quand on parle de renoncer, de gérer, de réorienter, tout conduit à se poser la question : quelle est la valeur des choses ? Monnin suit ici le philosophe pragmatiste John Dewey et sa pratique de l’enquête, qui permet de faire aboutir des “processus de valuation”. Je suis allé chercher une définition dans cet article :
De manière immédiate, valuer c’est aimer, terme qui peut se décliner par toute une série d’attitudes telles que « se soucier de », « prendre soin », « veiller sur », « chérir », « être dévoué », « s’occuper de », « prêter secours » ou encore « faire preuve de bienveillance ». C’est plus précisément priser (prizing) une fin et apprécier (appraising) les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cette fin.
Ce travail doit permettre de faire émerger le tissu de dépendances qui existe autour de chaque commun et ainsi de politiser les questions techniques (comment on produit tel déchet, tel gaz, tel dégât, comment on répare derrière, comment on se passe de telle ressource) les échelles planétaires (comment lier les causes et les effets dans l’espace) et temporelles (comment gérer les effets dans le temps des communs négatifs, cf. : les déchets nucléaires). Globalement l’urgence pour Monnin est de s’atteler à ce “chantier épistémique visant à produire les savoirs et les arts de la fermeture faisant actuellement défaut”.
Politiser la “viabilité” contre le capitalisme du désastre
Le travail sur le renoncement et la mise en place de processus de valuation amènent à poser la question de la viabilité. Engagés comme nous le sommes dans l’anthropocène, de plus en plus de zones, d’activités, de communs vont être déclarés non viables. Construire des résidences secondaires le long du trait de côte : non viable. Prendre l’avion : non viable. Or, au-delà des évidences qui pourraient sembler découler logiquement de la lecture des rapports du GIEC, cette notion de viabilité doit aussi être politisée. C’est à dire qu’elle doit être considérée, par les acteurs, comme une prise de décision politique (qui donc va impacter leur vie) à laquelle ils peuvent et doivent contribuer, à partir de leur expérience propre (cf. politisation sur wikipédia).
L’auteur cite Kasia Paprocki : ”La viabilité d’une communauté ou d’un mode de vie dépend non seulement des menaces physiques auxquelles elle est confrontée mais aussi du fait que l’on pense qu’elle est viable [ou non] en premier lieu”
La question, par exemple, de la viabilité de l’agriculture côtière du Bengladesh (et des modes de vie qui vont avec) a été discutée “en privé” par des experts des agences internationales. Un auteur a déclaré qu’elle n’était pas viable, ce qui a poussé à la délaisser au profit d’alternatives comme les polders et l’élevage de crevette, qui contribuent à la salinité des sols et donc… à la disparition de l’agriculture. Or, un autre rapport montrait que cette même agriculture pouvait être viable jusqu’à 2050.
Le capitalisme est toujours là, même lorsqu’il s’agit de faire face à ses effets délétères. Les “ruines anticipées” sont un risque majeur pour les communautés exposées. Contre les agents dominants en place (gouvernements, institutions) qui vont chercher à administrer le désastre et à délivrer des tampons de viabilité, il est nécessaire de politiser le renoncement, de le sortir d’une approche purement technique, afin d’éviter que soient ignorés les intérêts des populations concernées.
Valoriser le négatif
Penser et agir dans ce monde qui s’effondre, face à ces choses à abandonner, nécessite de concevoir les méthodes et les institutions qui peuvent permettre de “fermer, renoncer, désaffecter / réaffecter”. Or, ce travail se heurte, entre autres, à un biais psychologique : notre manque d’intérêt pour les résultats négatifs. Personne n’a reçu de promotion pour n’avoir PAS lancé un projet ou pour avoir arrêté une démarche en cours. Or, comme le montre aussi Nassim Taleb (il parle de “via negativa”, cf. cet article), ce travail de valorisation du négatif est essentiel.
L’auteur développe un exemple issu du monde de la recherche : Bruce Charlton, un professeur de médecine, a eu l’idée d’un “Journal des résultats négatifs”. Une publication qui mettrait en avant les hypothèses finalement non validées, des articles qui montrent ce qui ne marche pas, les pistes de recherche qui doivent être abandonnées. Une collection d’objets beaucoup moins sexy (et moins bénéfiques pour les carrières) que la publication de découverte, ou de résultats conformes aux hypothèses initiales. Des scientifiques ont pris au sérieux cette idée farfelue et ont réellement créé le Journal. Aujourd’hui, dans le monde de la recherche, le travail sur les résultats négatifs semble être plus largement accepté et faire partie des avancées “valables”.
Notre concept de commun négatif est maintenant précisé : il s’agit d’une entrée nécessairement politique dans les questions du rapport problématique entre des communautés humaines et leur environnement. Mais comment, concrètement, travailler sur ces communs négatifs et faire, in fine, des choix ?
La méthode : enquête, autogestion et suffisance intensive
Enquêter sur les attachements
Le risque principal d’une mauvaise lecture du concept proposé par l’auteur est illustré par le “capitalisme du désastre” ou par l’exemple de l’azote aux Pays-Bas : renoncer via des décisions centralisées, prises sans lien avec le “monde réel”, la vie des gens et sans considérer les effets de second ordre. Alors, comment éviter ces renoncements brutaux ? C’est là qu’intervient l’enquête.
L’auteur considère que le travail de déconnexion et de démantèlement des structures établies n’est, en réalité, pas une fin en soi. Il s’agit, en se “débranchant” partiellement de la technosphère, de faire enquête. Qu’est-ce que cela produit, si on arrête les piscines individuelles ? Si on diminue drastiquement notre dépendance au pétrole ? C’est en éprouvant le renoncement qu’on peut cartographier nos attachements et ainsi, faire des choix éclairés et limiter la brutalité de l’arrêt soudain. On peut par exemple commencer par refuser de réparer des systèmes en panne et voir ce que ça produit. Cette approche me fait penser à ce que ça doit être de retirer son exosquelette à un cyborg. Séparer soigneusement la machine de la chair, en sachant que cela peut être fatal, tester chaque lien qui unit l’artificiel au corps, entendre ce que le corps en dit…
La question de l’enquête est essentielle, car, pour Monnin, c’est la manière qui fait que le renoncement sera juste. Un “bon” renoncement est ainsi démocratique plutôt qu’autoritaire, anticipé plutôt que décidé au pied du mur, et surtout il est non brutal. On pourrait même parler de délicatesse. Un bon renoncement prend en compte les attachements, les recense et propose des alternatives.
Qu’est-ce qu’un attachement ? C’est le lien à la fois profond et en même temps contingent qu’on entretient avec quelque chose. C’est un passif au sens de l’addition que le passé tend au présent. Il ne se révèle que selon la situation et en même temps, il est impérieux. Pour simplifier, on peut penser à la cigarette : notre attachement au tabac est fonction du passé, des années passées à fumer, il peut disparaitre durant plusieurs heures et réapparaitre de façon extrêmement difficile à gérer dans un contexte donné (un stress, un besoin de pause, la consommation d’alcool). Ce même raisonnement s’applique à la voiture, au supermarché, au chauffage central, au travail salarié… L’attachement est donc une matière “molle” et difficile à saisir, autrement que par une observation attentive dans le temps.
Inventer l’autogestion de la fermeture
Pour Monnin, ce travail d’enquête sur les attachements concerne notamment les organisations : entreprises, collectivités, associations. Il s’agit d’acteurs qui ont, dès aujourd’hui, des choix à faire face à l’anthropocène et qui conservent une capacité d’action et d’expérimentation (ce qui est parfois moins clair pour les États par exemple).
Or, si les entreprises doivent s’engager sur le chemin de l’enquête, il est essentiel que l’invention des arts de la fermeture se fasse avec les travailleurs et les travailleuses ! C’est à la fois une exigence éthique (en lien avec la question de qui décide de la viabilité discutée ci-dessus) mais aussi pratique. L’action de redirection nécessite une connaissance concrète et sensible des réalités matérielles en jeu. Comment adapter un processus de production à l’absence d’une ressource ? Comment utiliser autrement les savoirs-faire disponibles ? Le renoncement est un savoir inductif, qui part de la base.
Au-delà des questions évidentes de pouvoir - qui décide, qui possède le capital, quelles alliances pour travailler sur le sujet, quels sont les intérêts en jeu - il me semble intéressant de questionner la méthode de renoncement. Si les conditions sont réunies, comment, concrètement, œuvrer en tant que travailleur·ses à la redirection de son activité ? Victor Ecrement et Diego Landivar ont par exemple conçu une fresque du renoncement. Je crois sincèrement que la facilitation a un rôle à jouer dans cette dynamique, en prenant en compte, au delà de la nécessaire précision des concepts, le fait humain dans sa dynamique : considération des émotions, rythme de réflexion, nécessité de bien poser le problème, méthodes pour décider à plusieurs...
Passer de la sobriété à la suffisance intensive
Dernier point que je relève dans ce livre riche et foisonnant : la problématisation de la question de la sobriété. La sobriété est présente dans tous les scénarios prospectifs qui s’intéressent aux questions écologiques. Et pourtant, ce terme est aujourd’hui complètement neutre et technique. Il n’est pas discuté et ramène des questions collectives à une injonction individualisante. Pour Monnin : “Il est grand temps de transformer l’enkrateia, la maîtrise de soi-même, en un projet collectif de recivilisation (”civiliser les pratiques modernes”). Autrement dit de faire de la sobriété un enjeu non plus infrapolitique ou individuel mais bien politique au sens absolu du terme.”
Un des axes de travail consiste pour moi à poser la question de la désirabilité de la sobriété. Le livre propose pour cela d’utiliser le concept de suffisance intensive, qui permet de passer d’une logique de manque ou de privation à une appréciation différente (et potentiellement joyeuse) de la réalité en question. Simplement, il s’agit de passer de Spotify qui propose un accès extensif à la musique (vous pouvez, à un moment donné, accéder à toute la musique du monde) à une expérience intensive qui soit suffisante. On pense évidemment à la musique live ou à la pratique d’un instrument : qu’est-ce qui génère le plus de joie ? Votre abonnement Spotify ou un bœuf avec des amis ?
Ce travail a un lien direct avec la question du renoncement : “Fermer sous une description implique une autre possibilité : extraire une propriété ou une performance de la chose à laquelle on renonce (la capacité à se baigner par exemple qui ne nécessite pas forcément l’infrastructure de la piscine) pour la transférer dans une autre, plus sobre, condition préalable au maintien d’attachements, à des communs négatifs ou non, de manière juste.”
Conclusion : hériter du passé et des avenirs invivables
Monnin propose une approche à la fois théorique et éminemment concrète de l’écologie. Il ne s’agit pas de renoncer à agir, ni de rêver un monde idéal qui n’arrivera jamais, mais de partir d’aujourd’hui et de penser les chantiers qui s’ouvrent devant nous. C’est une “écologie des milieux impurs” qui considère, à la façon d’Anna Tsing par exemple, qu’il nous faut maintenant apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme. Le XXIème siècle ne sera pas un retour aux sociétés agraires ni à une proto-industrialisation, il sera quelque chose de nouveau, dans lequel il s’agira de gérer ce que nous lègue le XXème siècle. A nous de nous organiser pour que les processus de décisions soient collectifs et qu’ils préservent les personnes concernées.
Pour lui, cette écologie là peut et doit démarrer en France, dès aujourd’hui (il a d’ailleurs lancé une formation pour des professionnel-les de la redirection !). Pourquoi ? “S’agit-il de se disputer la place d’avant-garde face à l’immensité à venir d’une catastrophe qui n’est plus un événement mais la rapide et continuelle dégradation des conditions d’habitabilité de la Terre“ ?
Non, il s’agit plutôt de continuer sur la route que nous avons tracé et d’assumer notre place particulière. En tant que pays du Nord, nous avons conçu et déployé un modèle qui n’a jamais eu vocation à devenir une règle générale (on ne pourra jamais tous vivre comme des Californiens) et dont il s’agit, aujourd’hui, d’hériter. “Si ces futurs sont obsolètes, il s’agit alors d’hériter à la fois de leurs matérialisations passées et des projets qui adviennent encore chaque jour en leur nom, les “ruines ruineuses” du présent et de l’avenir, à démonétiser symboliquement de toute urgence. Hériter du passé comme de l’avenir, dans un même geste”
Que faire donc ? Créer une nouvelle manière de faire, ici même où on a inventé ce qui allait nous conduire à l’anthropocène. Bifurquer. “Utopie ? Stratégie.”