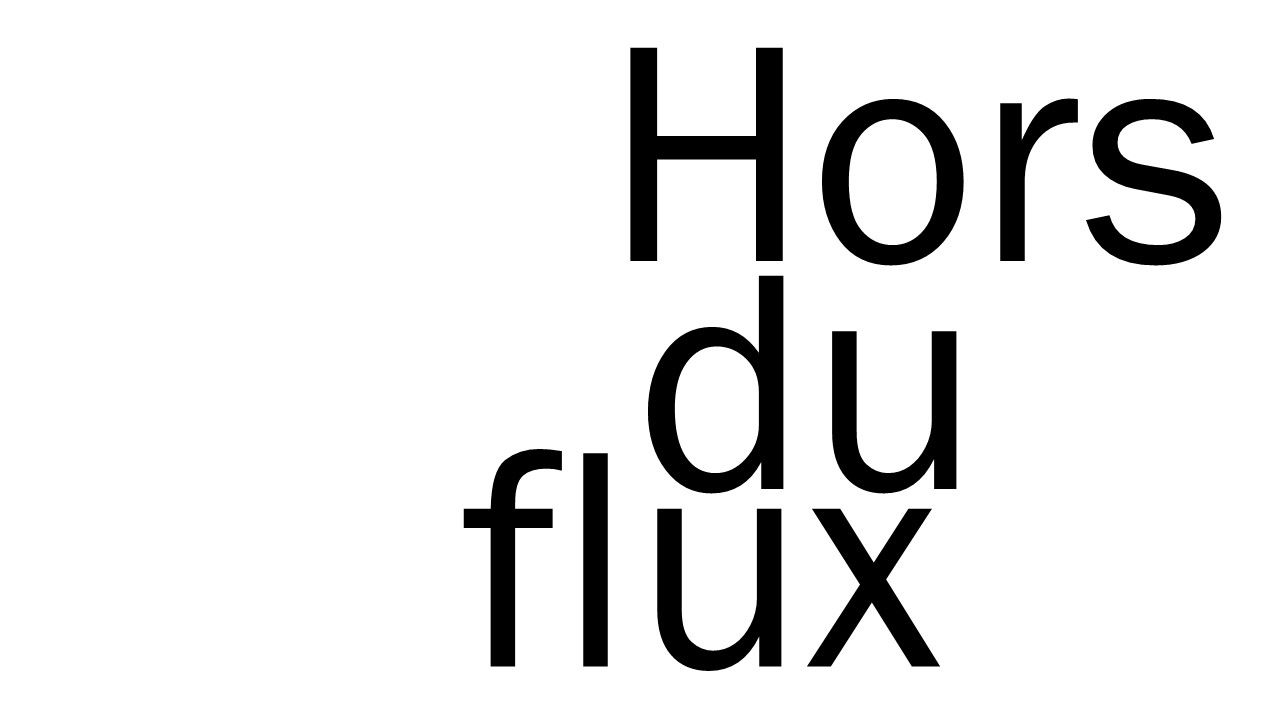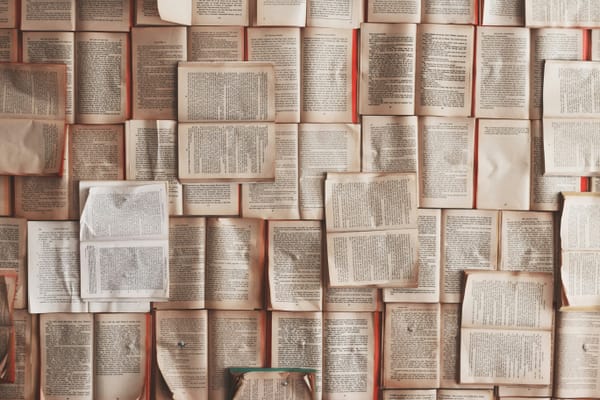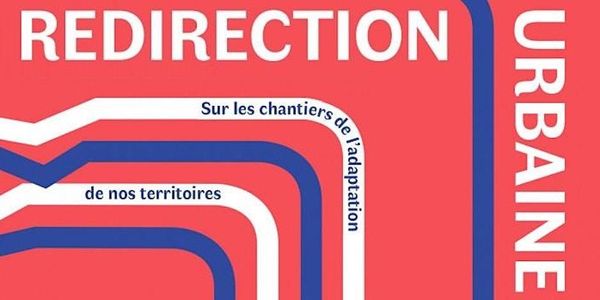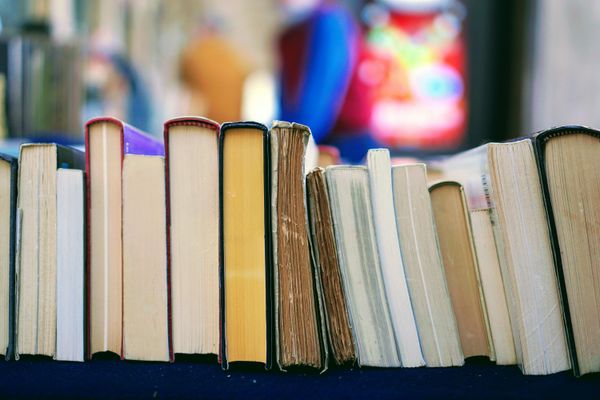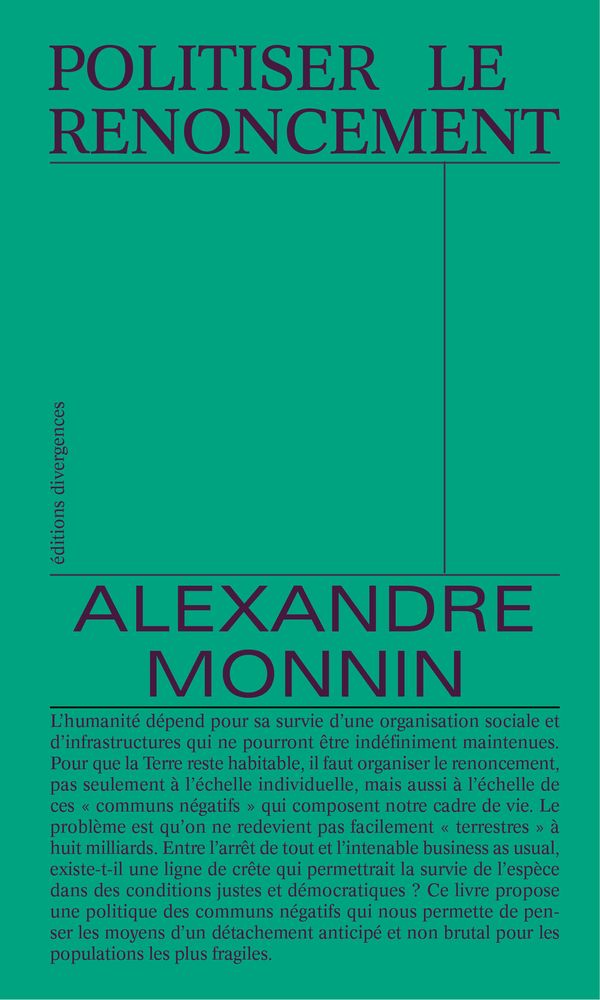Choses lues en 2024

Comme chaque année, voici la liste des livres que j'ai lus sur les 12 derniers mois. Ci-dessous, les listes précédentes :
- 2018 : 32 livres
- 2019 : 42 livres
- 2020 : 30 livres
- 2021 : 28 livres
- 2022 : 33 livres
- 2023 : 38 livres
- La base de données sous Notion de tous ces livres lus (ça reste assez brouillon)
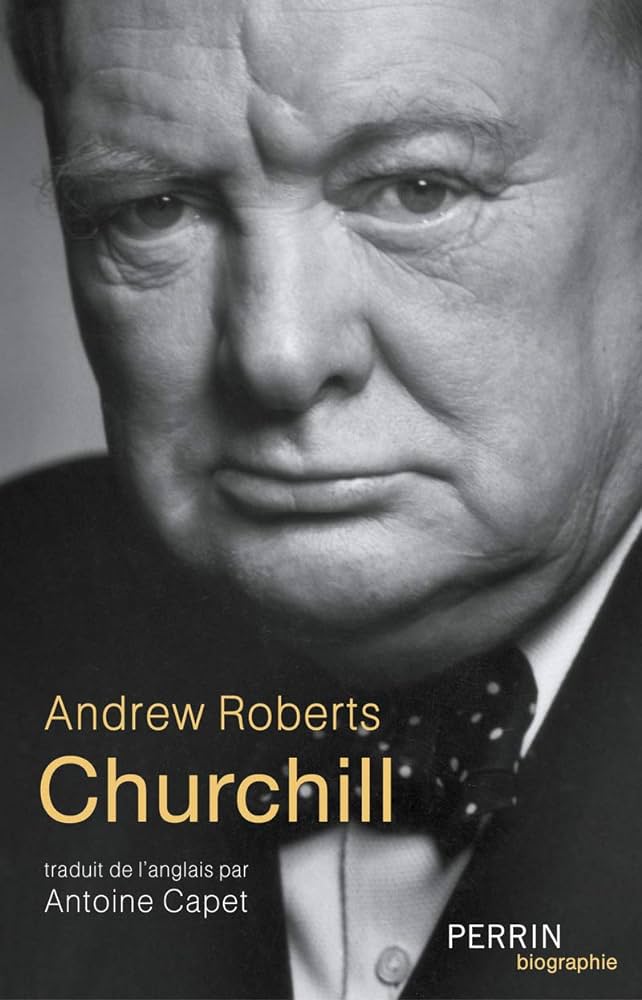
29 janvier 2024 : Churchill d'Andrew Roberts (2020)
Il est une chose vraie en littérature comme dans la vie : plus ça dure, plus ça marque. L'impression est fonction du temps passé. Un gros livre vous touche plus qu'un petit. Tout simplement parce qu'on y passe plus de temps, qu'on côtoie plus longuement ses personnages, qu'on glisse plus profondément dans ses phrases.
J'ai donc démarré 2024 avec Churchill et cette grosse biographie. 1300 pages à suivre les pas d'un des plus grands hommes du XXème siècle : une sacrée personnalité, pas commode, mais au fond très attachant. On pense tout d'abord à ce que Graeber et Wengrow nous rappelle, dans Au commencement était : la démocratie électorale est une héritière des sociétés héroïques, nées en - 3 000. Face au problème de la répartition du pouvoir, ces sociétés proposaient l'affrontement des héros. Ce qu'on retrouve finalement, dans le principe des élections : on fait s'opposer des personnalités hors du commun. Nos élus ne sont pas des gens normaux (ne serait-ce que parce qu'ils souhaitent avoir le pouvoir). Churchill était définitivement quelqu'un hors de la norme. Ce que dit cette biographie, c'est que c'est tant mieux. Que la rencontre de l'époque, la seconde guerre mondiale, avec sa personnalité, a permis à l'Angleterre de tenir face aux attaques nazies, au moment où la France s'effondrait.
Quelques points sur sa personnalité et la question du pouvoir.
Tout d'abord, il était buté, et c'était (très) difficile de travailler avec lui. ”Churchill n’était pas quelqu’un avec qui il était facile de travailler, et il n’était pas facile d’être sous ses ordres - loin de là. Il avait l’esprit de contradiction, il voulait toujours avoir raison, et il avait un certain côté autoritaire.” Mais cela s'accompagnait d'une capacité morale hors du commun (et notamment à faire face au stress dans les situations les plus dures, j'ai développé cette idée ici).
R.V. Jones, un physicien qui travaille à la recherche au Ministère de l’air :
“Ce fut pareil à chaque fois que je l’ai revu pendant la guerre - j’avais l’impression de recharger mes batteries au contact d’une source d’énergie vivante. Il y avait la force, la résolution, l’humour, la qualité d’écoute, le don pour poser la question cruciale et pour agir une fois convaincu. Il était avare de compliments à l’époque, aussi beaux qu’ils puissent avoir été par la suite, car il avait été élevé dans la sévérité. En 1940, c’était déjà un compliment que d’être appelé par lui en temps de crise, mais résister à son assaut de questions avant de le convaincre constituait la plus grande des exaltations.”
Lord Ismay, un général et proche collaborateur :
“Quand tout va comme il faut, il est bien ; quand tout va de travers, il est magnifique ; mais quand tout ne va qu’à moitié, il est insupportable.”
Ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'il importe peu de se tromper quand on fait de la politique. Churchill a commis beaucoup d'erreurs, que ça soit durant la première guerre mondiale ou ensuite. Mais il a tenu bon sur un point : le danger de l'Allemagne nazie et la nécessité de se réarmer, alors que tout le pays ne demandait qu'à détourner le regard et à croire dans les mensonges d'Hitler. C'est cela qui l'a qualifié pour être premier ministre.
Enfin, c'était un homme d'un autre temps. Né sous le règne de Victoria, il était convaincu de la supériorité de son pays, de la nécessité de l'empire, des bienfaits de la royauté. Il lisait beaucoup, dictait de grandes biographies historiques à des secrétaires qui le suivaient partout. Habité par un sens du destin, il vivait sa vie avec une idée de la grandeur : “Dans les faits, il passait son temps à se demander : “Que doit faire actuellement la Grande-Bretagne pour que le verdict de l’Histoire lui soit favorable.””
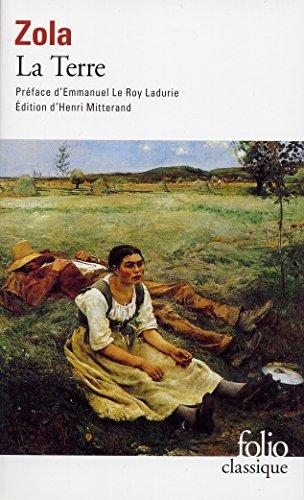
17 février 2024 : La Terre de Zola (1887)
Génial. Comme à chaque fois, lire Zola c'est se plonger dans dans des mondes incroyables. Les descriptions de la campagne de la Beauce sont géniales, l'histoire est super et on apprend plein de choses.
Le livre parle donc du lien des paysans à la terre. Ici, le moment de la léguer à ses enfants :
“Mais ce qu’il ne disait pas, ce qui sortait de l’émotion refoulée dans sa gorge, c’était la tristesse infinie, la rancune sourde, le déchirement de tout son corps, à se séparer de ces biens si chaudement convoités avant la mort de son père, cultivés plus tard avec un acharnement de rut, augmentés ensuite lopins à lopins, au prix de la plus sordide avarice. Telle parcelle représentait des mois de pain et de fromage, des hivers sans feu, des étés de travaux brûlants, sans autre soutien que quelques gorgées d’eau. Il avait aimé la terre en femme qui tue et pour qui on assassine. Ni épouse, ni enfants, ni personne, rien d’humain : la terre ! Et voilà qu’il avait vieilli, qu’il devait céder cette maîtresse à ses fils, comme son père la lui avait cédée à lui-même, enragé de son impuissance.”
On suit leurs vies dures, sans parole :
“Et, derrière la vache tirant sur la corde, ni l’un ni l’autre ne causaient plus, retombés dans ce silence des paysans qui font des lieues côte à côte, sans échanger un mot.”
“Seulement, est-ce qu’on sait ? De même que la gelée qui brûle les moissons, la grêle qui les hache, la foudre qui les verse, sont nécessaires peut-être, il est possible qu’il faille du sang et des larmes pour que le monde marche. Qu’est-ce que notre malheur pèse, dans la grande mécanique des étoiles et du soleil ? Il se moque bien de nous, le bon Dieu ! Nous n’avons notre pain que par un duel terrible et de chaque jour.”
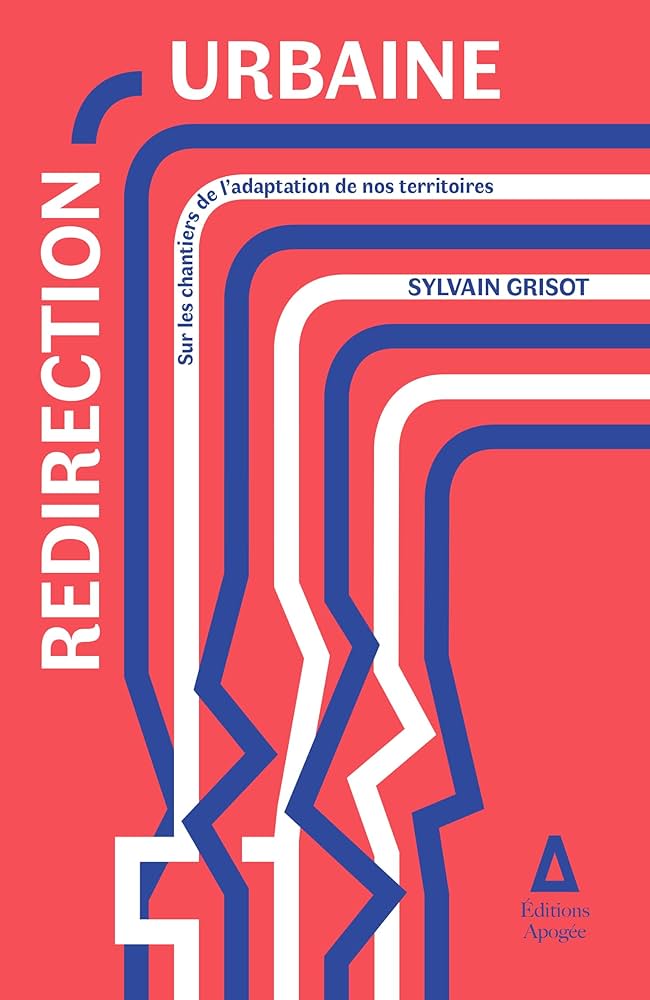
18 février 2024 : Redirection urbaine de Sylvain Grisot (2024)
Un super livre ! J'en ai fait une synthèse ici.
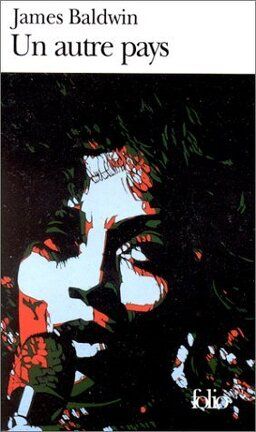
1er mars 2024 : Un autre pays de James Baldwin (1962)
Un très beau livre, sur les relations d'une bande d'amis, à New York, après le suicide de l'un deux. Les personnages naviguent sur des rivières de tristesse et d'alcool, incapables de se relier, de se parler, de s'aimer, de partager ce qu'ils ressentent. La faute à leurs névroses, mais aussi et surtout à cette société américaine des années 50, où les expériences des noirs et des blancs sont impossibles à partager.
L'autre pays que mentionne le titre, c'est la France (où Baldwin a longtemps vécu) mais aussi une utopie, un endroit où l'on pourrait être à l'abri du racisme et de son passé mais qui n'existe pas.
Sur le suicide :
“Tout ce que je sais moi, c’est que Dieu a fabriqué jusqu’au moindre pouce de la terre où je marche et tout ce que Dieu a fait est sacré. Et aucun de nous ne sait ce qui se passe dans le cœur d’autrui, et il y en a pas beaucoup parmi nous qui savent ce qu’il y a dans leur propre cœur ; alors personne peut dire pourquoi il a fait ce qu’il a fait. Aucun de nous était là, donc personne le sait. Faut prier pour que le Seigneur l’accueille, comme nous prions pour que le Seigneur nous accueille. C’est tout. C’est tout.”
Sur le fait de marcher à Harlem en étant blanc :
“Il savait que Harlem était un champ de bataille et qu’une guerre s’y déroulait jour et nuit - mais des objectifs de cette guerre, il ne savait rien. Cette ignorance ne provenait pas seulement du silence des guerriers - silence spectaculaire d’ailleurs étant donné la violence avec laquelle il retentissait - elle provenait de ce que l’on ne sait de la bataille que ce que l’on a accepté de soi-même”
Sur la difficulté de vivre :
“Et par cette soirée de printemps, remontant la longue rue noire et pleine de murmures vers le boulevard, Eric était la proie du désespoir. Il savait qu’il avait une vie à créer, mais il ne semblait pas pourvu des outils nécessaires.”
Sur l'amour :
“Il aurait voulu la secourir ; il regrettait qu’il ne fût pas en son pouvoir de l’aider, de rendre sa vie moins éprouvante. Mais l’amour seul pouvait accomplir ce miracle de rendre une vie plus supportable - l’amour seul, et l’amour lui-même échouait presque toujours ; et il ne l’avait jamais aimée.”
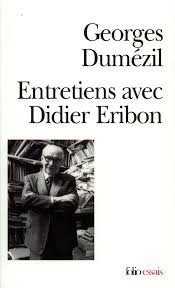
5 mars 2024 : Entretiens avec Didier Eribon de Georges Dumézil (1987)
Un livre très intéressant où Didier Eribon, alors journaliste, interviewe Georges Dumézil, un grand chercheur, en fin de carrière. Dumézil est un pur esprit, modeste, incroyablement cultivé, hors du temps. Il est connu notamment pour ses recherches sur les Indo-européens, cette civilisation qui aurait donné une grande majorité des langues européennes. Son travail consiste à aller chercher les similitudes entre les mythes indiens et les récits fondateurs romains, pour tenter de faire "apparaitre" ce peuple qu'on ne connaitra jamais, à travers les similitudes et notamment la répartition de la société en 3 fonctions.
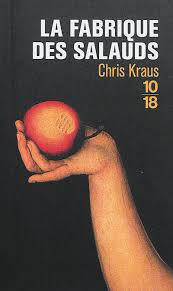
16 mars 2024 : La Fabrique des salauds de Chris Kraus (2019)
Un super livre, une grande fresque, qui suit la vie d'un homme, un allemand des pays baltes, entrainé dans la seconde guerre mondiale et qui va connaître un destin incroyable. C'est un récit très généreux, qui semble ne pas s'arrêter. Mais attention, on n'en ressort pas avec une vision très joyeuse de la vie et de l'Histoire. On aperçoit ce qu'étaient les allemands d'Europe de l'est au début du XXème siècle (c'est quelque chose qui est difficile à imaginer aujourd'hui, le fait qu'il existait de nombreuses communautés germanophones dans tous l'Est de l'Europe, jusqu'en Russie) ; on voit les Einsatzgruppen en action derrière la Wehrmacht durant Barbarossa ; mais aussi la naissance d'Israël et les étranges arrangements du Mossad avec d'anciens officiers nazis.
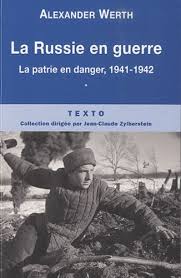
14 avril 2024 : La Russie en guerre I d'Alexander Werth (1965)
Un très beau livre dont la conclusion la plus évidente est : la guerre, c'est vraiment (vraiment) naze. Mais on apprend aussi d'autres choses :
- La capacité collective de résistance des Russes, leur esprit de sacrifice.
- Les allemands ont affamé Saint-Pétersbourg : il y a eu 1 M de mort dans une ville de 3 M d'habitants - et pourtant, même dans les moments les plus sombres, on a déploré très peu de vols, d'actes égoïstes.
- L'évolution du positionnement de Staline qui, pour allumer la flamme de la résistance, va relâcher la propagande communiste pour aller convoquer le nationalisme russe.
Sur ce dernier point, c'est très intéressant de noter que, lors d'un conflit, on ne va pouvoir utiliser qu'un stock limité d'idées ou de stratégie (cela rejoint l'idée répertoire d'idées disponibles et le dicton : "quand on sait pas quoi faire, on fait ce qu'on sait faire", développé ici) et que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.
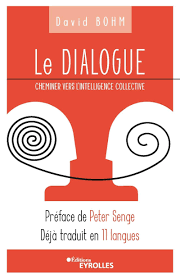
4 mai 2024 : Le Dialogue, cheminer vers l'intelligence collective de David Bohm (2021)
C'est ma collègue Joy qui me l'a prêté, dubitative, me demandant si je voyais quelque chose à en tirer. Le livre est assez mal foutu. C'est un recueil d'articles, il manque une introduction sur qui est David Bohm (un grand physicien), il y a beaucoup de longueurs et de banalités. Mais sur le fonds, ce que propose Bohm est assez intéressant. Le dialogue est une pratique, qui consiste à réunir des groupes de 20 à 30 personnes, en cercle, sans sujet particulier à traiter et... d'animer un échange.
Il s'agit, par la discussion, de faire émerger les croyances des uns et des autres. Ce n'est pas un débat, il n'y a rien à gagner contre les autres. Il s'agit de questionner ses hypothèses : “Il est vrai que le dialogue doit porter sur tout ce qui révèle une tension derrière nos hypothèses. Il participe du processus de pensée sous-jacent aux hypothèses, et pas seulement des hypothèses elles-mêmes.”
C'est une révélation de la capacité de nos processus de pensée de fabriquer le monde tel qu'il est. Il s'agit de penser la pensée et de chercher à se changer, en collectif, pour changer le monde.
Bon, concrètement, je n'ai pas vraiment compris comme c'était censé marcher !
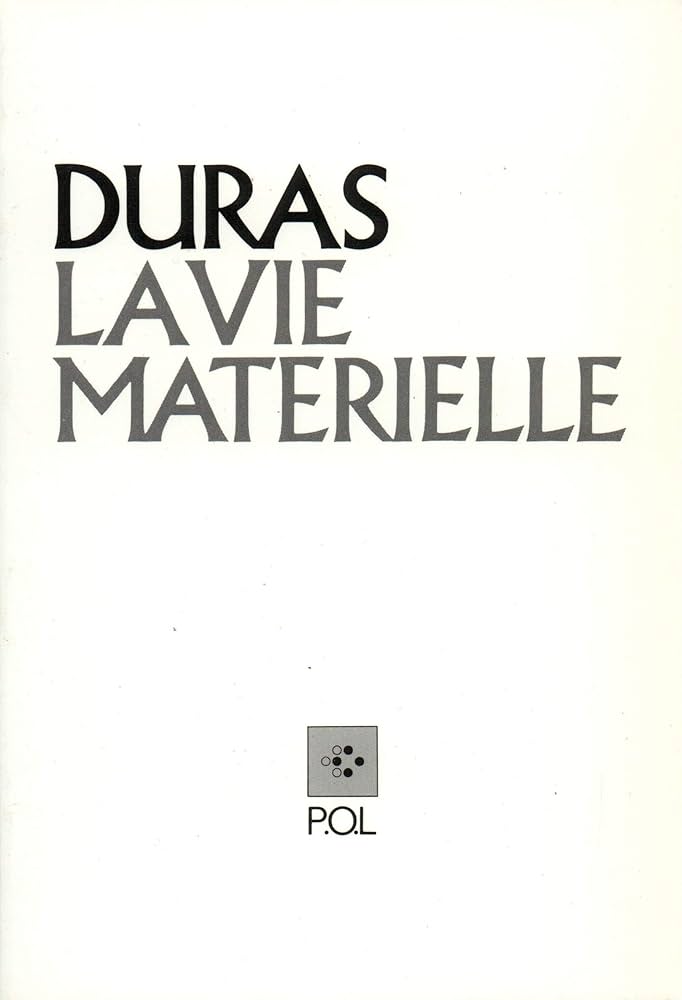
14 mai 2024 : La Vie matérielle de Duras (1988)
Note : c'est rigolo de noter qu'à un certain moment de classicisation, un auteur vient à n'être plus dénommé que par son nom de famille. Duras, Zola, Hugo. Mais James Baldwin, Chris Kraus, David Bohm.
Ça se mérite Duras. Il faut rentrer dans la phrase. Accepter le style. Ensuite, c'est fascinant : une vision du monde qui nous vient de loin, complètement amorale. Des passages sur les hommes et les femmes, énoncés comme des vérités (du genre : une femme a ses enfants et son mari, qui est aussi un enfant) qui choquent mais qui sont peut-être au fonds, une vérité profonde qu'on ne veut pas voir (une autre : au fonds, tous les hommes sont homosexuels !).
Les passages sur le délires lié au sevrage de l'alcool sont aussi impressionnants.
Quelques morceaux choisis.
Sur Dieu et l'alcool :
“On manque d’un dieu. Ce vide qu’on découvre un jour d’adolescence rien ne peut faire qu’il n’ait jamais eu lieu. L’alcool a été fait pour supporter le vide de l’univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. L’homme qui boit est un homme interplanétaire. C’est dans un espace interplanétaire qu’il se meut. C’est là qu’il guette. L’alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l’homme. C’est le contraire, l’alcool conforte l’homme dans sa folie, il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée.”
Un mauvais bleu :
“Une couleur sans génie, un mauvais bleu tout à coup. Une différence très ténue mais rédhibitoire, ou, tout au contraire peut-être, et tout aussi bien, l’absence d’une ombre, partout, sur la mer et sur la terre. Et dans les yeux ce voile très doux du manque d’amour.”
Les femmes, les hommes :
“Il faut subvenir aux besoins de l’homme, comme à ceux des enfants. Et c’est également un plaisir, pour la femme. L’homme se croit un héros, toujours comme l’enfant. L’homme aime la guerre, la chasse, la pêche, les motos, les autos, comme l’enfant. Quand il dort ça se voit, et on aime les hommes comme ça, les femmes. Il ne faut pas se mentir là-dessus. On aime les hommes innocents, cruels, on aime les chasseurs, les guerriers, on aime les enfants.”
La phrase durassienne :
“Depuis vingt ans, on me dit que ce que j’ai c’est de l’emphysème. parfois je le crois, souvent je le crois, quelquefois je ne le crois pas.”
Sur le délirium trémens et les visions :
“Pourquoi était-ce aussi insupportable ? Tellement insupportable que ça vous enlève jour après jour toutes raisons de vivre ? Sans doute parce qu’on est seul à voir ce qu’on voit, alors qu’on est habitué à seulement être seul à penser ce que l’on pense.”
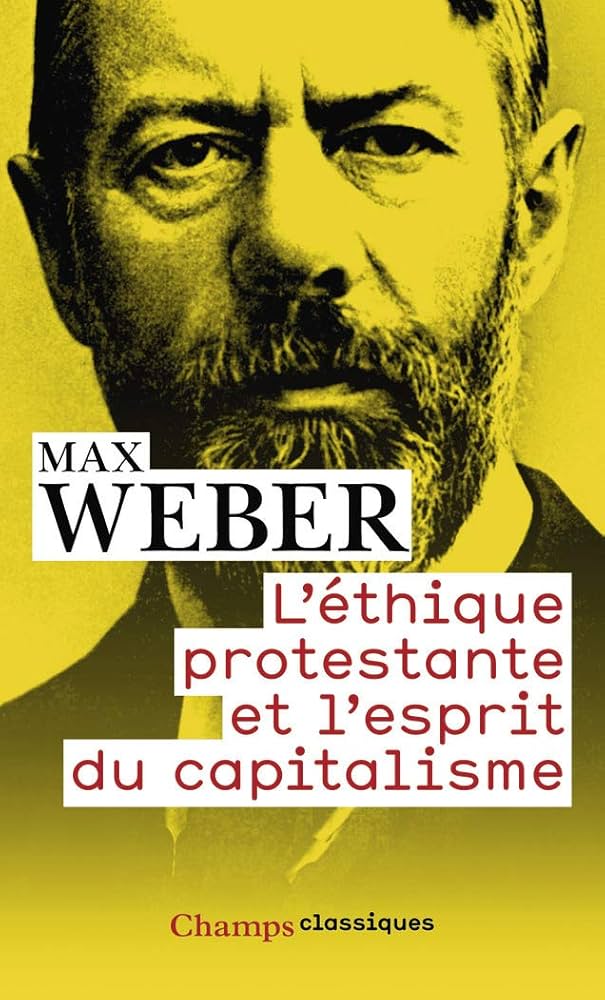
19 mai 2024 ; L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904)
Trop bien. C'est vraiment lumineux, Max Weber. On le suit dans une enquête : comment expliquer les différences économiques entre les communautés protestantes et les autres ? Pour lui, cela relève d'une forme d'évènement dans l'histoire de la pensée religieuse (et ce n'est donc pas que le pur produit des conditions matérielles) : l'apparition d'une idéologie très particulière au sein de sectes protestantes (calvinistes, quakers...) qui a poussé les hommes à s'identifier à leur travail, à chercher le succès dans les affaires tout en vivant une vie ascétique (la vie monacale dans la vie normale) et donc à réinvestir en permanence leur profit. Cette composition singulière a donné un avantage économique majeur à ces communautés et, comme par un effet de cliquet, à forcé tout le monde à fonctionner ainsi : c'est l'esprit du capitalisme.
J'en avais fait une petite synthèse sur LinkedIn.
“Le puritain voulait être un homme besogneux - et nous sommes forcés de l’être. Car lorsque l’ascétisme se trouva transféré de la cellule des moines dans la vie professionnelle et qu’il commença à dominer la moralité séculière, ce fut pour participer à l’édification du cosmos prodigieux de l’ordre économique moderne. Ordre lié aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et machiniste qui détermine avec une force irrésistible le style de vie de l’ensemble des individus nés dans ce mécanisme - et pas seulement de ceux que concerne directement l’acquisition économique. Peut-être le déterminera-t-il jusqu’à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se consumer. Selon les vues de Baxter le souci des biens extérieurs ne devait peser sur les épaules de ses saint qu’à la façon d’”un léger manteau qu’à chaque instant l’on peut rejeter”. Mais la fatalité a transformé ce manteau en une cage d’acier.”
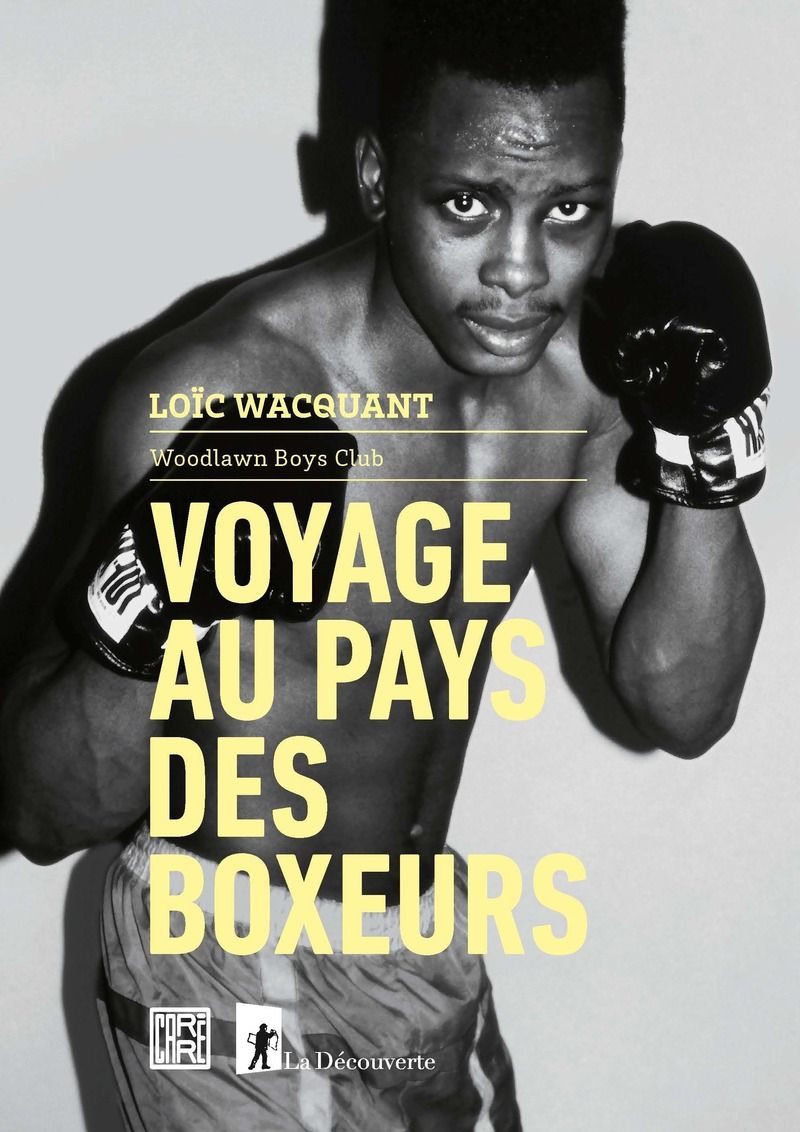
1er juin 2024 : Voyage au pays des boxeurs de Loïx Wacquant (2022)
J'avais adoré Corps et âmes, le précédent livre de Loïc Wacquant sur la boxe. Il y racontait comment, étudiant en doctorat de sociologie à Chicago à la recherche d'un terrain d'enquête, il avait poussé les portes d'un gym, une salle de boxe, du quartier noir jouxtant l'université et qu'il s'était pris de passion pour le noble art jusqu'à participer aux Golden gloves, la grande compétition amateure américaine.
Dans ce beau livre, il revient sur ses années et, avec des photos, des notes, il suit cette question : comment se fait-il que ces hommes acceptent de se soumettre à ce mode de vie si dur alors que la chance d'en vivre sont aussi faibles. La réponse en un mot : la possibilité de se donner une éthique, une distinction, dans un environnement social et économique chaotique.
Ça me touche car j'aime la boxe et je me demande aussi parfois pourquoi je poursuis (très modestement) ce masochisme.
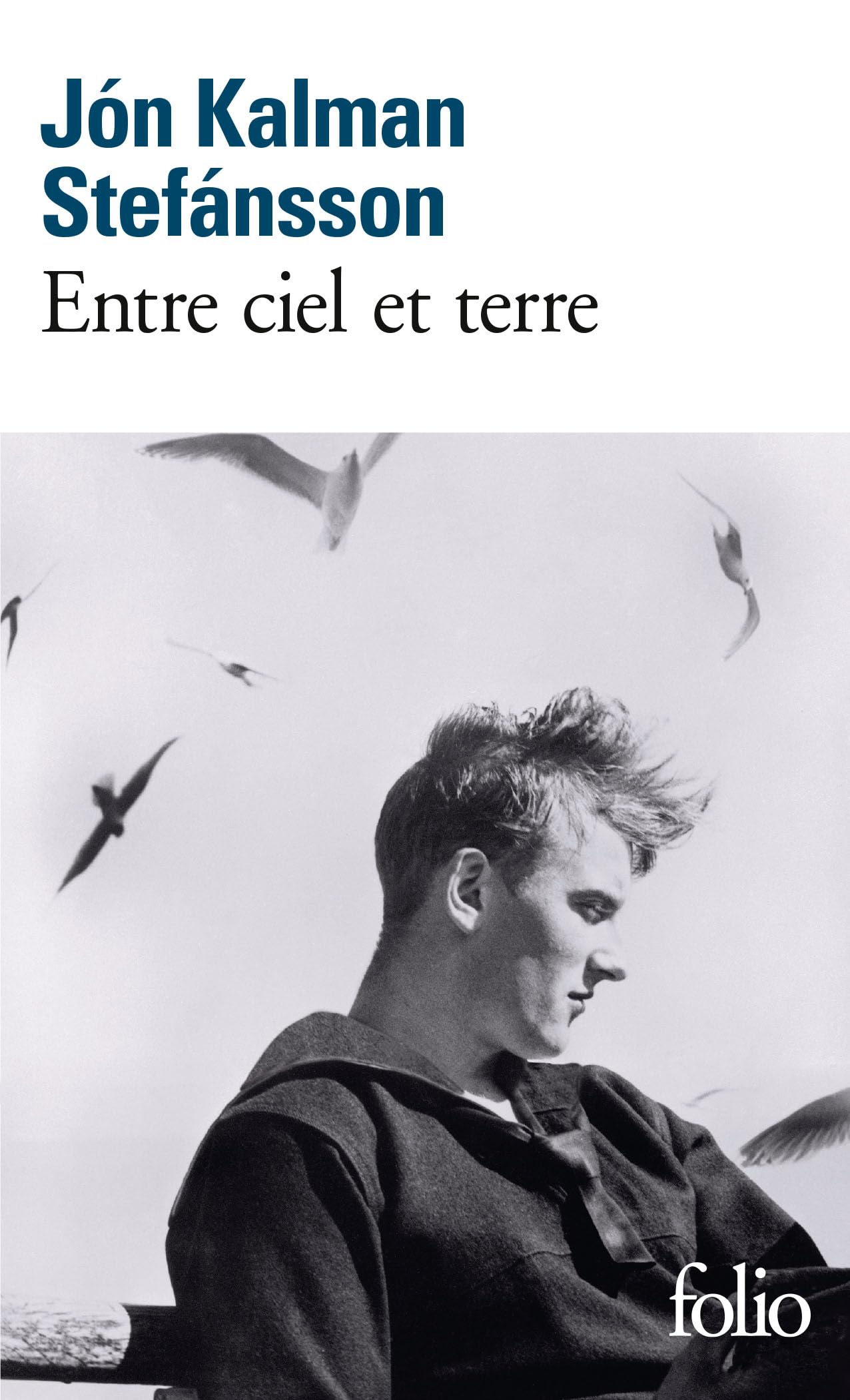
9 juin 2024 : Entre Ciel et terre de Jon Kalman Stefansson (2010)
Un très beau livre sur des pêcheurs islandais au début du XXème siècle. C'est une écriture étonnante, poétique, qui nous amène à toucher du doigt la dureté de l'existence de ces femmes et de ces hommes, mais aussi la beauté, au quotidien, l'amitié, l'amour.
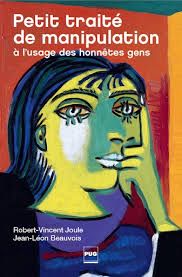
26 juin 2024 : Petit Traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Joule et Beauvois (1987)
Ce livre a été un succès étonnant. Un travail de vulgarisation de recherche en psychologie sociale qui est devenu un best seller. J'en avait beaucoup entendu parler. Je l'ai enfin lu.
C'est intéressant. Mais c'est aussi très pénible à lire. Beaucoup trop long, trop de détails sur les différentes pratiques de manipulation. J'aimerais en faire une synthèse simple, pour transmettre les quelques idées utiles.
Ce qui est surtout insupportable, c'est à quel point ça a mal vieilli dans la narration. On écoute les auteurs qui parlent comme des vieux profs fan de contrepèteries nous raconter les histoires de Madame O et empiler les clichés misogynes : elle est femme au foyer, elle s'ennuie et elle aime dépenser l'argent de son mari.
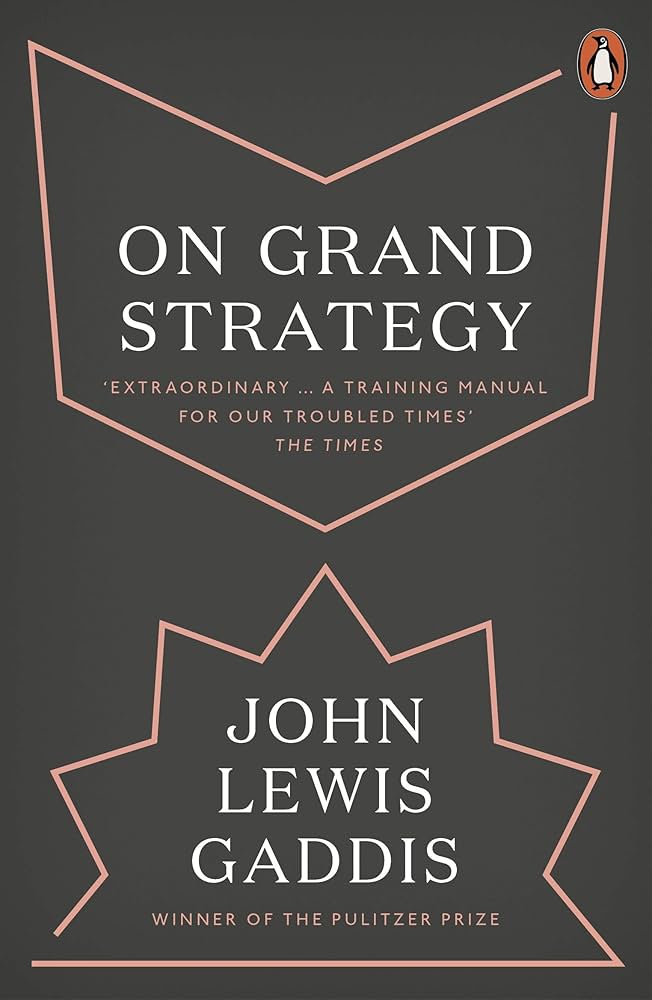
2 juillet 2024 : On Grand strategy de John Lewis Gaddis (2018)
C'est une relecture. J'étais un peu passé à côté la première fois. Ou en tout cas je le croyais. En fait je réalise que beaucoup d’idées m’ont marquées (par exemple cette histoire de Renard et de hérissons). Ce livre m’a notamment poussé à lire d’autres livres. Guerre et Paix par exemple. Un des propos de l'auteur est qu'on comprend mieux les sujets de stratégie en lisant les grands classiques de la littérature que la production savante la plus récente.
J'ai eu le sentiment de passer à côté lors de ma première lecture car c'est écrit dans un anglais soutenu. Une langue sophistiquée, riche, beaucoup plus difficile d'accès que les manuels que je lis habituellement. Mais aussi parce que tout l'enjeu du livre est de transmettre des idées qui, au fonds, peuvent être des banalités. Les grands apprentissages des militaires, politiques et écrivains des siècles passés, trop synthétisés, peuvent sonner creux. Mais Gaddis, par son érudition et son art du récit, parvient à toucher et à transmettre des idées qui restent, sans qu'on s'en rendre vraiment compte.
J'en ai fait une petite synthèse sur LinkedIn.
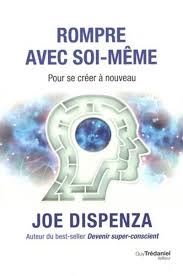
27 juillet 2024 : Rompre avec soi-même de Joe Dispenza (2013)
Alors c'est assez drôle. Ce livre m'a été conseillé par mon énergéticienne (oui, je vois parfois une énergéticienne, c'est très efficace quand ça va mal). C'est clairement de la pseudo-science. Tous les voyants s'allument quand on commence à le lire.
Il faut donc accepter de laisser de côté son cartésianisme pour entrer dans le sujet et s'intéresser au contenu. Le propos de l'auteur est le suivant : nous sommes activement responsable de nos malheurs car nous entretenons le mythe de notre identité et donc de tous les défauts qui vont avec. Il faut, par un travail de méditation, "rompre avec soi-même" pour pouvoir profiter de la vie, en visualisant avec intention ce qu'on se souhaite.
Sur le fonds, je suis assez d'accord. C'est une variante de la méthode coué. Avec une touche de physique quantique. Mais au fonds peut importe que ça soit l’œuvre de l'univers, de Dieu, de l'effet Placebo ou de l'auto-persuasion : cultiver des visions positives aide à ce que le positif advienne dans la vie (regardez Churchill !). Le conseil : cherchez à ressentir la gratitude liée à l'accomplissement de ce que vous souhaitez avant que ça n'arrive (et ça arrivera).
Là où c'est plus dur à suivre, c'est quand Dispenza annonce guérir des cancers par la méditation. Mais bon, c'était pas la grande forme au moment où je l'ai lu et ça m'a aidé (il y a aussi quelques podcast intéressants où il développe ses idées, pas forcément besoin de s'infliger le bouquin).
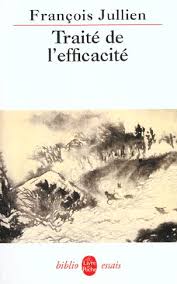
28 juillet 2024 : Traité de l'efficacité de François Jullien (1996)
Un superbe livre. J’avais lu Les Transformations silencieuses, qui est la continuité de celui-ci (et j'en avais fait une petite synthèse). Il s’agit encore une fois de confronter la pensée chinoise à la nôtre afin d'éclairer notre métaphysique, nos façons de voir et d'identifier des pistes pour agir autrement dans le monde actuel.
Avec ce style hyper particulier (une langue qui cherche, qui se promène, qui nous emmène, au plus près des concepts), François Jullien nous amène ici dans une enquête autours des écrits chinois antique sur les questions de stratégie.
Chez les Grecs, celle-ci est affaire de grande volonté, mais aussi de hasard. Nous avons construit un sujet qui se doit d'être libre pour écrire sa destiné. Nous sommes passionnés par l'héroïsme, les actes de gloire. Le reste, c'est une affaire de chance.
Les Chinois, eux, se posent des questions différentes. Ils ne s'intéressent pas à la métaphysique, à la question des origines. Leur question c'est : comment le réel arrive. Ils sont sensibles aux cycles, aux influences, à l'environnement. Ils construisent donc une vision de la stratégie entièrement différente où le bon stratège est celui qui gagne le combat sans combattre. Il est comme l'eau, qui sait déplacer les pierres les plus lourdes : il s'appuie sur l'environnement, minimise les efforts, manipule les hommes pour s'assurer de la victoire, qui doit être jouée d'avance (pas de place pour les actions glorieuses).
C'est une pensée dure, qui voit des ennemis partout, mais qui est particulièrement intéressante car elle permet de nous décentrer et de devenir un peu plus adapté à la complexité du monde actuel.
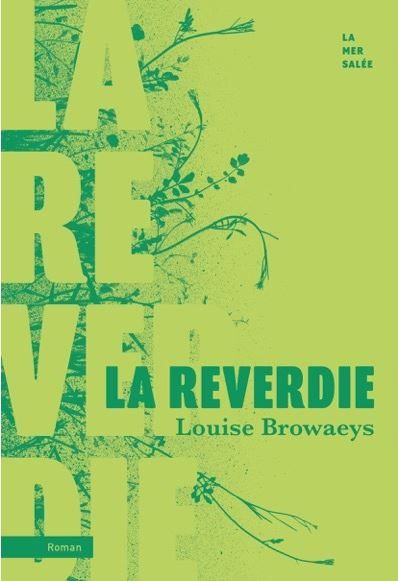
30 juillet 2024 : La Reverdie de Louise Browaey (2023)
Un beau texte qui questionne sur comment vivre dans cette époque de crise écologique. Mais aussi (et surtout, pour moi), un texte sur l'amour, une déclaration de l'autrice à son compagnon, être providentiel, sauveur simple, rassurant.
Passages choisis :
“Après avoir délaissé mes livres sur le bien-être animal et tout en continuant le deuil de ma brouette, je tombe sur cette phrase de Nashiki Kaho : “Il n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui de vivre simplement, de vivre une vie simple et sincère.” C’est peut-être ce que je cherche aussi, par dessus tout.
Depuis que je t’ai rencontré, cela semble à portée de main. Vivre et écrire autrement. Connaître le désir qui dure en moi. Ne pas accepter la vie telle que nous la proposent les hommes et la publicité. Inventer avec toi un petit bonheur qui claque au vent comme un coquelicot de mai et qui consiste à se voir le plus possible, rire, parfois pleurer, s’entraider, faire l’amour le matin, se préparer du thé à longueur de journée, faire le ménage à tour de rôle, ne pas cesser de se toucher, ne pas baisser les bras, ça jamais, transformer les conflits en compost et se pardonner.”
“Rassurons-nous. Aucune relation n’est une perte de temps. “Si elle ne vous a pas donné ce que vous cherchiez, elle vous a montré ce dont vous aviez besoin.”, nous dit Christine Singer en bonne permacultrice, qui transforme d’un claquement de doigts les contraintes les plus déchirantes en opportunités.”
“La vie passe ainsi par nous pour éclore en amour.”
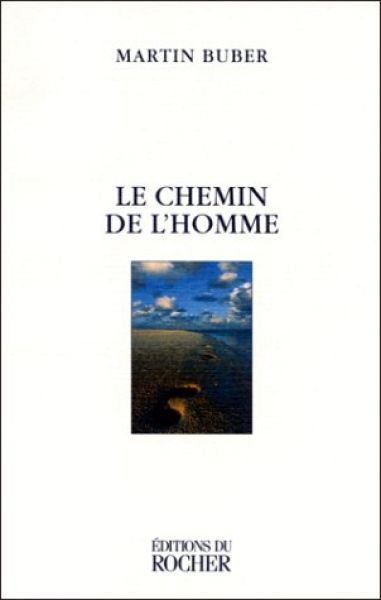
30 juillet 2024 : Le Chemin de l'homme de Martin Buber (2015)
Un très beau texte que m'a conseillé mon ami Antoine. Comment penser notre relation aux autres, au monde et celle que nous avons à nous-même ? Faut-il penser à soi, ou est-ce de l'égoïsme? Comment savoir ce qu'on doit faire de sa vie, ce qui est juste ? Martin Buber, un des grands philosophe juifs du XXème siècle nous donne des clés pour traiter ces sujets.
C'est plein d'histoires de Rabin qui donne des conseils à des apprentis un peu patauds. Comme Rabbi Mendel de Kotzk :
”Ce que je demande à chacun de vous ? Trois choses seulement : de ne pas lorgner au-dehors de soi, de ne pas lorgner au-dedans du voisin, et de ne point penser à soi.” Ce qui veut dire : premièrement, chacun doit maintenir et sanctifier son âme propre dans la manière et le lieu qui sont les siens, et ne pas convoiter la manière et le lieu des autres ; deuxièmement, chacun doit respecter le mystère de l’âme de son prochain et s’abstenir de le pénétrer avec une impudente indiscrétion et de l’utiliser à ses fins ; et, troisièmement, chacun doit dans sa vie avec soi-même et dans sa vie avec le monde, se garder de se prendre lui-même pour but.”
C'est aussi une pensée religieuse qui donne une belle place aux hommes (et aux femmes ;)) :
“Dieu veut entrer dans son monde, mais c’est par l’homme qu’il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du genre humain.”
J'en ai fait une synthèse sur LinkedIn.
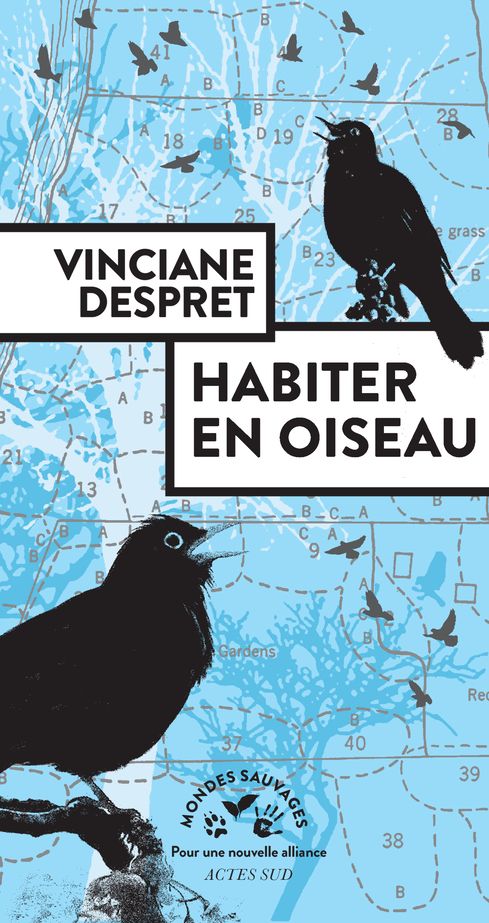
1er août 2024 : Habiter en oiseau de Vinciane Despret (2019)
Lu sur les conseils de mon ami Ahmed, un très beau livre, qui - et c’est toujours génial - parle d’une question que je ne m’étais jamais posée. Comment les oiseaux font-ils territoire ? Ou plutôt, que pensent celles et ceux qui les observent et comment font-ils évoluer leur perception de ce qu'est un territoire ?
Le concept apparait au début du XXème siècle et vient bouleverser l’ornithologie. On observe en effet que de nombreuses espèces, à certains moment de l’année, vont avoir des comportements "territoriaux". C’est à dire qu’ils vont se mettre à défendre un leiu, à se l'approprier, à l'arranger. Dans un espace donné, sur un temps donné, leur comportement va radicalement changer. Pourquoi ?
Derrière l’évolution du concept et le passionnant récit qu’en fait Vinciane Despret pointent les limites de notre compréhension de l'autre non-humain et la nécessité d'élargir la focale, de renouveler nos outils théoriques et pratiques. Il s'agit, finalement, de multiplier le monde, de le rendre plus vaste, mystérieux, riche, enrichissant.
J'en ai fait une petite synthèse sur LinkedIn.
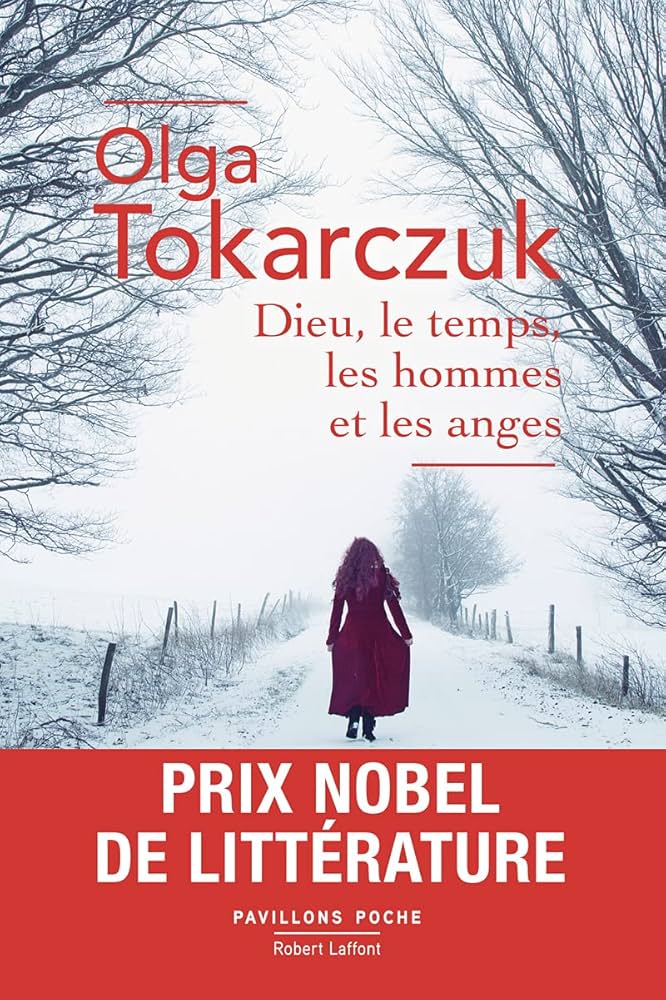
6 août 2024 : Dieu, le temps, les hommes et les anges d'Olga Tokarczuk (1996)
Un conseil de mon cousin Pierre : un très beau livre, très étrange. C'est tout à fait cohérent, j'ai trouvé, avec le livre de Vincianne Despret : à la lecture de Dieu... on assiste à une multiplication du monde. On suit la vie des différents habitants d’un village de Pologne. Dans un univers à la fois réaliste et magique, on suit un homme des bois, l’esprit d’un mort, une âme, différentes personnes. Tout est étrange et beau. Crédible aussi. La multiplication des points de vue fonctionne : Dieu, le mycélium, un aristocrate bipolaire pris dans un jeu fou, une mère de famille, un parvenu de l’ère soviétique.
J'en ai aussi fait un post sur LinkedIn.
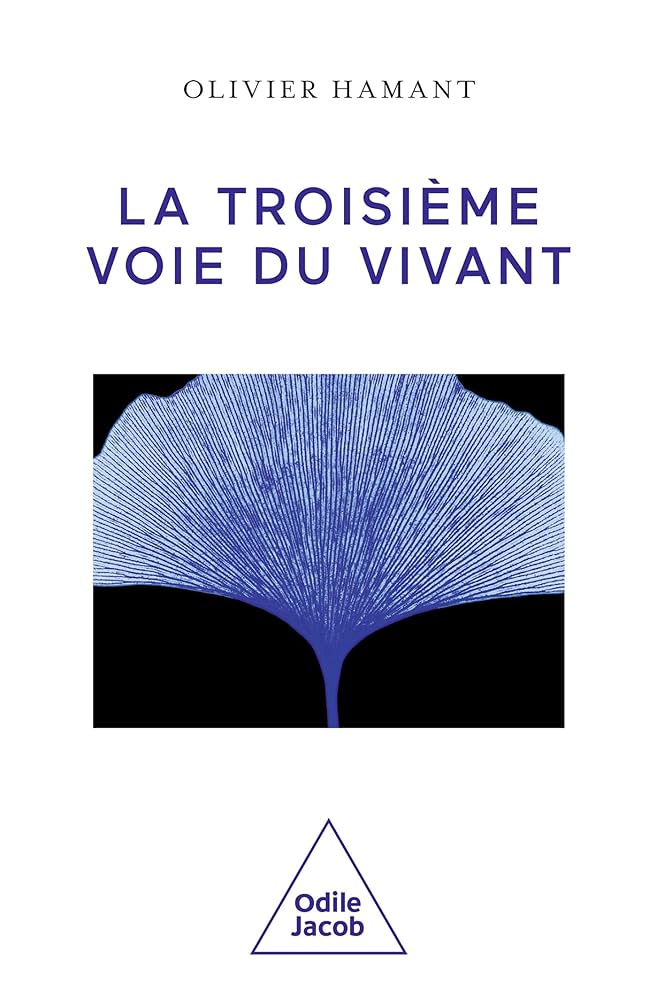
10 août 2024 : La Troisième voie du vivant d'Olivier Hamant
J'ai été assez déçu par ce livre. C'est une référence parmi celles et ceux qui réfléchissent à la transition et Hamant est beaucoup cité pour sa capacité à décaler notre regard.
J'ai essayé de résumer superficiellement son propos dans ce post LinkedIn.
Le livre démarre par une bonne introduction à la crise environnementale actuelle (mais où je n’ai pas appris grand chose). Puis l'auteur fait le lien avec la notion de performance. Je suis passé un peu vite, c’est assez convaincant, mais peut être rapide. Suit un exposé fouillé de comment les systèmes vivants cultivent la sous optimalité. C'est intéressant (on est dans le cœur de spécialité de Hamant qui est biologiste) mais parfois dur à suivre (bon, j'ai toujours été nul en bio). Enfin, le livre propose une série de conséquences possibles de cette notion pour les affaires humaines.
C’est là que le bât blesse. Je suis bien sûr d'accord avec ses propositions, mais elles me semblent bien plus être le produit évident de ce que pense - par déterminisme sociologique - un universitaire de gauche que le résultat d'un raisonnement sur la nature des systèmes et la notion de sous-optimalité.
Par exemple : l’impôt. Pour l’auteur, cela serait plus robuste d’avoir un impôt progressif. Mais, en se basant sur les mêmes principes tirés du vivant, on pourrait arguer qu’avoir une entité centralisé (l’état), plutôt que des entités disjointes (les riches) pour décider de quoi faire du surplus d’argent, ce n’est pas exactement de la robustesse.
De la même manière, son opposition entre système social et système libéral me parait hyper rapide. On pourrait très bien arguer qu’un système de type social est fortement centralisé, parfois corrompu et que c’est assez fragile…
Bref, sur ces sujets, j'ai largement préféré Nassim Taleb, dont les vues politiques diffèrent des miennes, mais qui, il me semble, expose les réelles conséquences d'une prise en compte des enjeux de système hyper importants de l'époque (pour lui : la notion de fragilité et d'anti-fragilité).
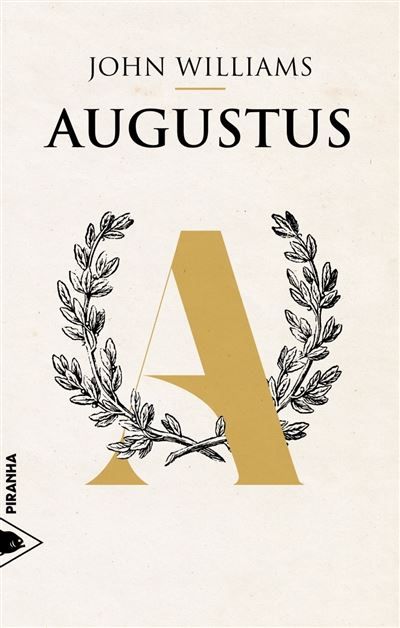
16 août 2024 : Augustus de John Williams (1972)
J'ai décidé d'arrêter un peu avec le seconde guerre mondiale et d'aller visiter l'antiquité. Je suis tombé sur la référence à ce livre dans On grand strategy. Cela semblait alléchant : une biographie romancé d'Auguste, le premier empereur romain et un des plus grands dirigeants ayant existé.
La promesse était belle, mais j'ai trouvé le livre très décevant. Le format épistolaire nous fait passer à côté de l'immersion dans l'époque, l'environnement, le contexte. On suit les évènements de loin et on n'apprend pas grand chose sur le pouvoir, sur la période, sur la vie...
Pour suivre ce que c'est d'être empereur romain (quelques années plus tard), il vaut mieux livre Mémoires d'Hadrien de Yourcenar.
Passages choisis :
“Et il me semble que le moraliste est la plus inutile et la plus méprisables des créatures. Il est inutile parce qu’il consacre son énergie à juger plutôt qu’à acquérir des connaissances car juger est facile et apprendre difficile. Il est méprisable parce que son jugement reflète une vision de lui que, dans son ignorance et sa fierté, il voudrait imposer au monde.”
Auguste : “Néanmoins, je compris, davantage par instinct que par raison, que si le destin d’un homme est de changer le monde, il lui faut d’abord se changer lui-même. S’il doit obéir à son destin, il doit trouver ou inventer en lui une part secrète et dure, indifférente à sa personne, aux autres et même au monde qu’il est destiné à refaire, non pas selon son propre désir mais selon une nature qu’il découvrira ce faisant.”
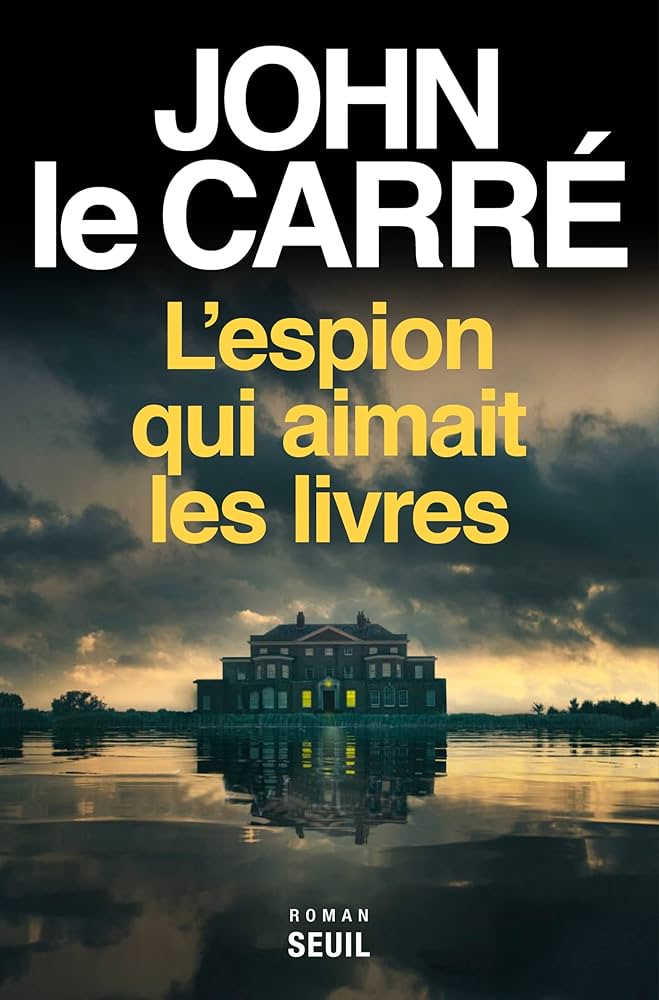
18 août 2024 : L'Espion qui aimait les livres (2021)
Après 2 livres qui ne m'ont pas plus, en plein pendant les vacances, j'ai ressenti la nécessité de rebondir. Pour cela, quoi de mieux qu'un livre de John Le Carré ? Le drame, c'est qu'il nous a quitté. La source s'est tarie. Mais son fils a ressorti un manuscrit qu'il a fait publier.
C'est, comme à chaque fois, une réussite. L'intrigue se révèle progressivement, d'une façon toujours délicate, faite de creux, de non-dits. Le Carré mise sur notre intelligence de lecteur. On ne comprend jamais vraiment tout, mais c'est toujours génial.
Je suis vraiment triste qu'il soit mort.
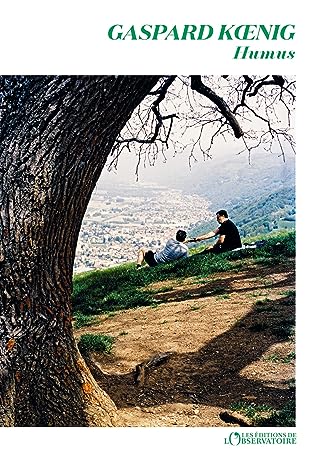
2 septembre 2024 : Humus de Gaspard Koenig (2023)
C'est mon camarade Sébastien qui m'a prêté ce livre il y a quelques mois. J'avais des réserves. Un récit sur l'engagement écologiste, par un auteur qui se réclame du libéralisme politique... Je suis toujours frileux sur les roman trop contemporains qui tentent de saisir l'ère du temps.
Je dois dire qu'en l’occurrence, j'ai trouvé ça vraiment bien. On suit les destins de 2 étudiants d'Agro Paritech qui vont avoir des stratégies de vie différentes. Ce qui touche, c'est la connaissance fine qu'a l'auteur des sujets écologiques et des sols, ainsi que sa capacité à décrire finement les choix, parfois idéalistes, de jeunes écolos.
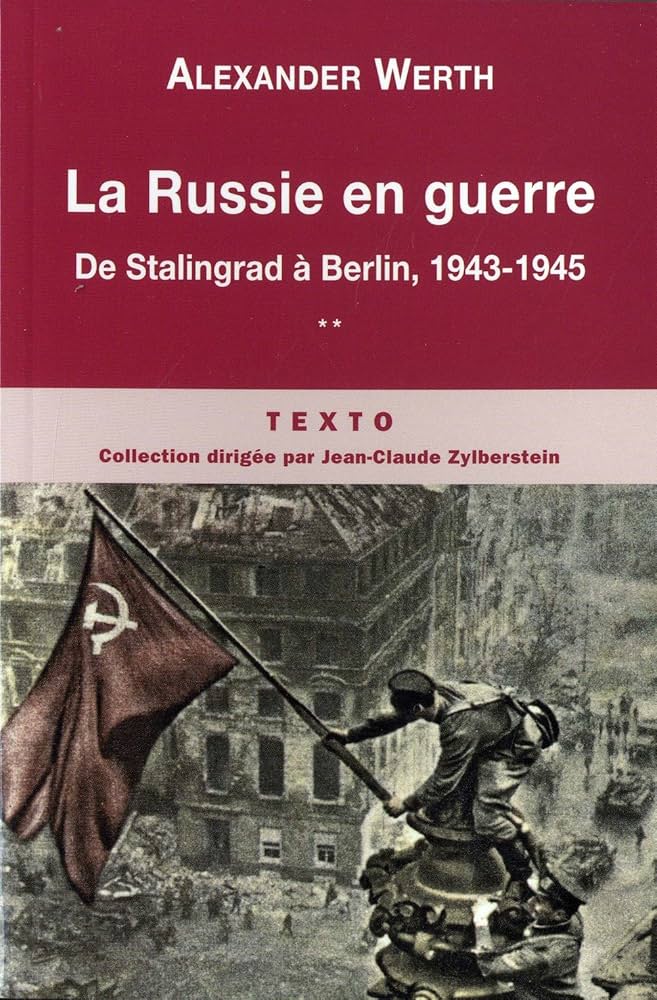
22 septembre 2024 : La Russie en guerre II d'Alexander Werth (1965)
Mon dernier livre, pour un moment, sur la seconde guerre mondiale. Il complète et donne à voir l'envers de La Fin de Ian Kershaw. C'est un beau livre, qui mêle journalisme de terrain (l'auteur, un allemand de Russie dont les parents ont émigré en Écosse au moment de la révolution était reporter et a passé les années de guerre en Russie) et travail d'historien.
On voit notamment l'état d'esprit très particulier des Russes vers la fin de la guerre :
“La Russie présentait alors [deuxième moitié 1944] un visage paradoxal : malgré de gigantesques pertes en vies humaines, malgré les immenses ravages commis par les armées allemandes dans le pays malgré toutes les épreuves et tout le dénuement dont souffraient les villes et les campagnes le pays tout entier éprouvait un grand orgueil et sentant qu’ils accomplissait quelque chose d’immense.”
L'auteur rappelle, évidement, le prix si lourd qu'a payé la Russie pour faire tomber l'Allemagne : 20 M de morts. Dont 7 M de soldats (3 M meurent dans les camps de prisonnier allemands). Parmi les morts civiles, il dénombre 2 M de juifs et 1 M à Léningrad. C'est une guerre contre le peuple russe qu'a mené l'Allemagne.
Ce qui m'a le plus ému, je crois, c'est la fin de la préface, rédigé par Nicolas Werth, son fils, grand historien de la Russie. Derrière le texte, il dit l'homme, avec une pudeur tragique quand on devine l'impact des choix du père sur le fils. Je recopie le texte ici, car, je crois, il capture quelque chose du champ des possibles de la vie parmi les femmes et les hommes (et qu'il m'émeut beaucoup) :
“L’expérience de la guerre sur le front de l’Est marqua profondément Alexander Werth, élevé dans un milieu allemand à Saint-Pétersbourg et devenu citoyen britannique à la suite de l’exil de son père en Grande-Bretagne. L’odeur du sang et des charniers, la vision des corps déchiquetés des combattants, des civils décapités par les éclats d’obus, des pendus décomposés sur la grand’place d’Orel le poursuivirent jusqu’à la fin de sa vie. Le contact direct dans les villes soviétiques libérées puis à Majdanek, avec la violence génocidaire nazie bouleversa ce fin connaisseur de la culture allemande, élevé dans le culte de Goethe et de Schiller. Il rejeta totalement, radicalement, cet héritage allant jusqu’à refuser désormais de s’exprimer dans cette langue que les nazis avaient subvertie. A l’inverse, il magnifia la part russe de son héritage et de sa culture. Non qu’il crut que sa Russie - celle de son enfance - pût renaître ; rien ne lui était plus détestable que la nostalgie du passé cultivée par les Russes en exil. Il exalta, au contraire, tout ce qui lui apparaissait aller dans le sens d’une réconciliation entre le peuple russe et son régime : ces humbles héros, simples soldats ou hauts officiers ayant gravi dans l’épreuve tous les échelons de la hiérarchie militaire ; ces paysans qui malgré tout ce qu’ils avaient enduré depuis la collectivisation forcée des campagnes, s’étaient engagés dans les rangs des partisans ; ces ouvrières exploitées des usines Kirov de Leningrad prêtes à tous les sacrifices pour contribuer à l’effort national de cette Grande guerre patriotique.
Après l’accueil triomphal, malgré un tirage volontairement limité par les autorités, de La Russie en guerre en URSS, à l’automne 1964 (quelques semaines avant le limogeage de Nikita Khrouchtchev) Alexander Werth décida de rédiger un nouvel ouvrage, qui devait s’intituler La Russie en paix, consacrée à l’URSS des années 1960. Années marquées par la sortie du stalinisme, l’émergence d’une véritable société civile et d’espaces de micro-liberté, un formidable foisonnement culturel ; mais aussi par la persistance de terribles blocages idéologiques et économiques. De 1965 à 1968, Alexander Werth passa plusieurs mois, chaque année, en URSS, travaillant sans relâche à La Russie en paix jusqu’à ce jour fatal d’août 1968 où les troupes soviétiques envahirent la Tchécoslovaquie. Pour lui, cet évènement marquait la fin des deux idéaux qui avaient donné sens à sa vie : pour l’homme engagé à gauche, l’idéal d’un “socialisme à visage humain” ; pour celui qui avait accompagné le peuple russe dans l’épreuve de la Grande guerre patriotique, l’idéal d’une Russie enfin apaisée.
Adieu, ma Russie - tel fut l’ultime message qu’Alexander Werth laissa, le 5 mars 1969, avant de mettre fin à ses jours.”
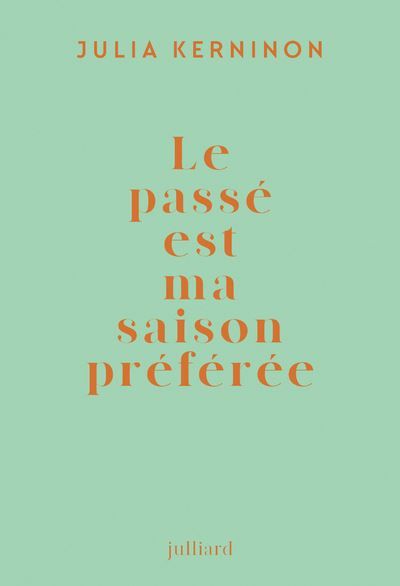
26 septembre 2024 : Le Passé est ma saison préférée de Julia Kerninon (2024)
Un très beau livre de Julia, court, dense, sur la figure incroyable de Gertrude Stein. Ça parle de style, de grammaire, de la place des femmes en littérature, de la nécessité de bousculer les normes.
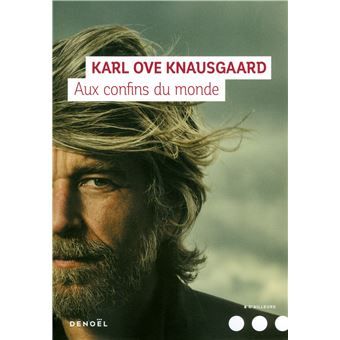
8 octobre 2024 : Aux Confins du monde de Karl Ove Knausgaard (2017)
Je continue, patiemment, Mon Combat, cette incroyable projet littéraire de Karl Ove Knausgard : une autobiographie radicale, une plongée sensible dans la vie de cet homme un peu trop attentif. C'est toujours aussi bien. Il y a ce quelque chose de très particulier des livres qui viennent du Nord, une forme de confort, de bien être qui se dégage des descriptions apaisées des plats, des paysages, des bâtiments. Mais aussi, cette acuité incroyable, qui nous amène au plus près du réel de ce que peut être la vie. Je crois qu'il me reste 2 tomes à lire.
Dans Aux Confins du monde, il a 18 ans et décide d'aller passer un an tout au Nord de la Norvège pour enseigner. On suit toujours son rapport compliqué à son père, un personnage assez odieux :
“Je me disais qu’il fallait que je me comporte le mieux possible avec lui. Quoi qu’il fasse, je serais un bon fils.
Cette décision intervint exactement en même temps qu’un coup de vent venu de la mer et les deux phénomènes se lièrent en moi d’une façon insolite, ils avaient un côté rafraîchissant, comme une délivrance après une longue journée de surplace.”
Le livre parle évidement de ses émois amoureux, de ses difficultés dans le domaine sexuel. Il réussit à capturer quelque chose de l'intensité des émotions de l'adolescence :
“Oh, ceci est la ballade d’un jeune homme qui aime une jeune femme. A-t-il le droit d’employer le mot “aimer” ? Il ne sait rien de la vie, rien d’elle et rien de lui-même. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il n’a encore jamais rien ressenti d’aussi fort et d’aussi clair. Tout fait mal mais rien n’est aussi bon. Oh, ceci est la ballade du jeune de seize ans dans un autocar, en train de penser à elle, l’unique, sans savoir que les sentiments iront s’émoussant et s’affaiblissant, et que la vie, si vaste et prodigieuse qu’elle soit à ce moment-là, ira inexorablement rapetissant pour atteindre une dimension praticable, quelque chose qui fait moins mal mais qui n’est plus aussi bon.”
“Un sentiment d’euphorie m’envahit car le silence était immense comme la mer est immense, en même temps qu’une douleur s’y logeait, comme dans toute joie.”
Enfin bien sûr, ça parle aussi pas mal de son rapport à l'alcool :
“Pourquoi ne buvaient-ils pas ? Pour est-ce que tout le monde ne buvait pas ? L’alcool rend tout grand, c’est un vent qui souffle sur la conscience c’est des vagues qui se brisent, des forêts qui se balancent et une lumière qui dore tout ce que tu vois, parant même d’une certaine beauté la personne la plus laide et la plus répugnante, c’est comme si toute objection et tout jugement étaient balayés d’un revers de la main, et comble de générosité, tout, je dis bien tout, était beau. Pourquoi dire non à ça ?”
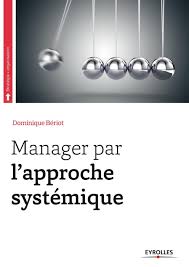
13 octobre 2024 : Manager par l'Approche systémique de Dominique Bériot (2006)
Un livre intéressant, sur comment appliquer les enseignements de l'école de Palo Alto autour d'une perspective systémique du changement aux affaires des organisations. C'est franchement pas un plaisir à lire, mais la méthode est riche. Je suis en train de travailler à une synthèse.
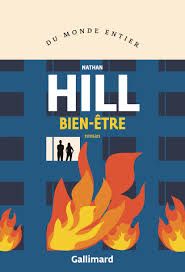
30 octobre 2024 : Bien-être de Nathan Hill (2024)
Peut-être mon coup de cœur de l'année. Un grand roman américain, incroyable de profondeur, d'intelligence et d'émotion. On suit la vie d'un couple de la classe moyenne en difficulté. Mais derrière, de nombreux sujets de sociétés apparaissent. L'auteur parvient, par la fiction, à traiter de thématiques extrêmement contemporaines comme nos façons d'élever des enfants, la détresse morale des banlieusards aisés (j'ai retrouvé des références implicites très drôles aux théories de Joe Dispenza), l'effet Placebo, l'art moderne et les ravages causés par les algorythmes des réseaux sociaux.
Bref, trop bien.
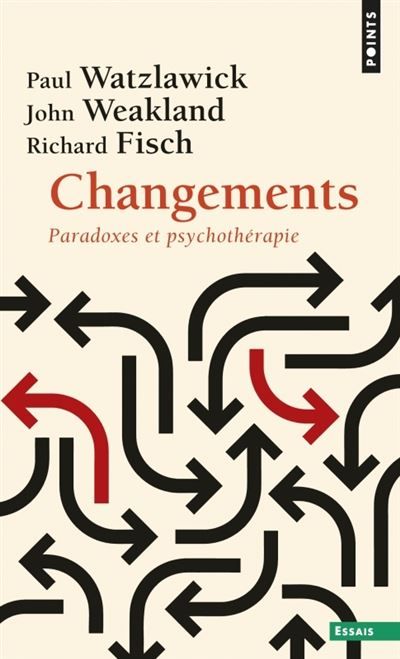
10 novembre 2024 : Changements de Watzlawick & al. (1975)
Très sympa. Je commence à avoir lu pas mal de bouquins de la bande de Palo Alto. On retrouve certaines idées (les niveaux logiques par ex.) et le style (les analogies riches, avec les théories mathématiques par exemple) qui font le succès de leurs publications. Ce n'est pas mon préféré - Une logique de la communication est un des livres les plus importants que j'ai lu ces dernières années - mais il est quand même bien.
Le propos, simplifié, est le suivant : il existe 2 types de changements - le type 1 et le type 2. Dans le type 1, on change des choses mais le système corrige et finalement, rien ne change. C'est le changement de type 2 qui est le vrai changement. Celui où les règles du système évoluent. Or, ce changement, on ne sait pas comment il fonctionne. En tout cas, pas par l'effet de la volonté. Il existe des pistes, comme les injonctions paradoxales, qui peuvent aider. Mais (et c'est une idée largement développée dans Manager par l'approche systémique) on s'en fout complètement de comprendre comment ça marche. Le sujet, c'est de réussir à produire le changement souhaité.
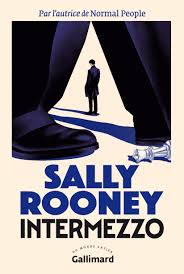
16 novembre 2024 : Intermezzo de Sally Rooney (2024)
Le dernier Sally Rooney. Un évènement éditorial. Il faut dire que c'est vraiment bien. Dans son style étrange, mélangeant dialogue et description, elle nous fait naviguer dans les vies intérieures de deux frères.
J'ai particulièrement aimé les scènes de nuit, dans Dublin. L’atmosphère intense, la pluie, les lumières, avant les moments de retrouvailles.
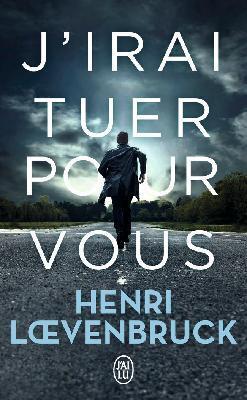
22 décembre 2024 : J'irai tuer pour vous d'Henri Loevenbruck (2018)
C'est ma collège Isabel qui me l'a prêté. J'avais tenté les premières pages il y a quelques mois, mais j'étais dubitatif : le héro sauve une fillette des griffes de méchants très méchants. Bof. Mais ensuite, c'est un vrai bon livre d'espionnage qui décrit de façon hyper réaliste comment peut fonctionner l'emploi de clandestins par la DGSE, dans une intrigue hyper chouette.